Articles récents
Une femme, ma mère
11 juillet 2020
L’album de famille impossible de Claude Demers
Catherine Bergeron

La photographie a cette capacité étonnante et poignante de donner à voir un certain quelque chose qui a été, disait fameusement Roland Barthes. Elle porte en elle cette qualité lui permettant d’arrêter un instant qui sera ensuite communiqué sous une autre forme. Cette photographie, que l’on pourrait nommer « amateur » et « de famille », trouve sa magie dans le fait que quelque chose a simplement existé devant la caméra. La force de la photo de famille serait donc exactement cela : la famille. Elle arrive à mettre en images cette famille que l’on reconnaît comme faisant partie de nous, cette famille qui point de manière à nous dire un peu plus qui nous sommes. Mais comment reconstruire et partager notre histoire lorsqu’on possède aucune image?
Construit comme une suite de tableaux vivants, de photographies en mouvement, le dernier long-métrage de Claude Demers, Une femme, ma mère (2019) (Grand prix de la compétition nationale longs-métrages aux RIDM), se présente comme le magnifique, touchant et gigantesque album de famille de celui qui, douloureusement, se trouve en quête de sa propre histoire. Poursuivant les préoccupations classiques du cinéaste (D’où je viens, 2014), tournant autour des thèmes de l’adoption, la mémoire, la filiation, l’héritage et la réconciliation, le film propose une incursion tout en douceur et en vulnérabilité dans l’enquête menée par le cinéaste pour retrouver sa mère biologique, l’ayant abandonné à la naissance.
Évoluant dans le Québec des années 1950, alors que la Grande Noirceur, avec son régime conservateur et clérical, tire à sa fin devant la mouvance nécessaire et incontrôlable d’un peuple cherchant la modernité et la mise à niveau, la mère de Demers est présentée comme cette femme moderne, tristement victime de cet entre-deux. Ne voulant jamais avoir d’enfant, elle a porté ce bébé dans la honte et l’amertume, criblant son ventre de coups, s’exilant lors de sa grossesse et accouchant, seule et anonyme, dans une crèche de Montréal. Claude Demers est ainsi né, raconte-il, d’une mère qui a tout fait pour brouiller les pistes de sa propre existence, une mère qui, l’abandonnant sans nom, le fera nommer « Jarry », comme tous les autres bébés étant nés dans la même semaine.
Ces histoires, nous les apprendrons d’une seule manière : elles seront racontées par la voix empathique et sereine du cinéaste. Par la parole, il retracera son enquête, accumulant les rencontres, les lectures de registres et les embauches de détectives pour arriver jusqu’aux retrouvailles, qui seront loin du conte de fée. Comme une longue lettre adressée à sa mère, il partagera ses états d’âme, ses doutes et questionnements, en portant toujours en lui un respect et un amour inconditionnels pour celle qui, cherchant le bonheur, n’a pu faire autrement.
Sans aucune image de cette quête ou de cette rencontre, le film utilisera alors le motif même de la vie de Demers pour lier la voix à l’image : l’adoption. Car c’est en adoptant une série d’images qui ne lui appartiennent pas, une série de portraits de femmes, réunis par la beauté de leur noir et blanc, et leur référence commune à la femme du milieu du siècle dernier, que le cinéaste traduira en images son périple. Film de montage, Une femme, ma mèreoscille ainsi visuellement entre des images d’archives documentaire, des images tirées d’autres œuvres cinématographiques et des images reconstituées par le cinéaste et son équipe. Toujours différentes, les femmes apparaissent pourtant à l’écran sous l’image d’une femme : la femme moderne, belle, séduisante et distinguée; la femme vivant dans les clairs-obscurs, celle tant aimée par le cinéma et les Grands qu’ont été Truffaut, Bergman, Resnais, Marker, Brault ou Groulx. Par son adoption des images, Demers adopte donc aussi la femme d’une époque, une époque révolue pendant laquelle sa mère a vécu et a grandi. Anonymes, fictives ou véritables, peu importe : ces femmes existent toutes comme l’image de celle que sa mère aurait pu être.
Évoluant dans le même espace-temps qu’Une femme, ma mère, Roland Barthes disait inoubliablement dans La chambre claire qu’il possédait cette image parfaite de sa mère chérie, mais que, impossible à partager pour que tous ressentent la même chose, il ne la partagerait jamais. Comme une réponse à Barthes, l’œuvre de Demers arrive comme la création même de cette image qui, pour le cinéaste, reste inatteignable. Chaque femme devient une fabulation permettant à Demers de s’écrire. Le cinéma arrive ainsi, ici, comme cet art offrant miraculeusement la chance de produire une image parfaite devant une histoire imparfaite, de créer, par la force du pardon, une mère belle et idéale devant la mère victime avalée par son temps. Hommage poignant aux mères et aux parents qui acceptent de prendre en mains leur rôle, ode sensible aux femmes qui ont le droit de vouloir autre chose, mais aussi testament de l’histoire d’un peuple et d’un moment qui ont connu une grande transformation, Une femme, ma mèrenous donne envie d’aimer, d’accepter et de pardonner comme peu de films arrivent aussi délicatement à le faire.
Les siffleurs
2 juillet 2020
Crimes et sifflements
Jérôme Michaud

Siffloter sa chanson préférée avec élégance n’est pas l’apanage de tous, mais il faut dire que l’on a rarement à le faire, les soirées endiablées de karaoké ne demandant pas d’entrer dans ce genre de technicalité, qui redonnerait pourtant un peu de lustre aux classiques souvent maltraités au petit matin. Cela dit, savoir siffler n’est pas du tout essentiel et personne ne perdra la vie s’il ne maîtrise l’art de former de petits bruits stridents émanant de sa bouche, à moins qu’il ne se trouve inexplicablement plongé dans l’univers des Siffleurs, dernier opus du déstabilisant cinéaste Corneliu Porumboiu. Partant de la pratique traditionnelle du langage sifflé silbo gomero pratiqué sur l’île de La Gomera dans l’archipel des Canaries, le cinéaste roumain s’inspire du film noir pour élaborer une intrigue alambiquée, mais finement ficelée dont les quelques apories sont rapidement pardonnées.
Dans une atmosphère où tout le monde est sous écoute, où chacun tente de protéger ses arrières et de dissimuler ses intentions, Cristi, impassible policier de la brigade des stupéfiants de Bucarest, s’est acoquiné avec la pègre, ne cessant d’informer son contact Zsolt de l’enquête menée contre lui, la faramineuse somme de 30 millions d’euros étant en jeu. Suite à l’arrestation de Zsolt, que Cristi a tenté en vain de prévenir, ce dernier se rend à l’île de La Gomera, rejoindre Gilda, femme fatale dont le charme l’a envouté, et le reste de la bande de mafieux afin d’apprendre avec eux à gazouiller le silbo gomero, et ce, dans le but d’utiliser ce moyen de communication secret pour faciliter l’évasion de Zsolt. L’art de siffloter devient ainsi l’élément pivot de la stratégie de libération, le moindre faux pas pouvant, théoriquement, mener à des conséquences tragiques.
On peut d’emblée reprocher à Porumboiu de se servir superficiellement du langage sifflé sur lequel il s’attarde pourtant longuement. Le silbo gomero, qui réduit le langage parlé à deux voyelles et quatre consonnes, aurait pu causer des quiproquos majeurs qui auraient servi de ressorts narratifs à l’intrigue, mais il n’en est rien. Cela dit, l’approche adoptée par le cinéaste produit une idéalisation d’un moyen de communication hautement faillible, mettant alors l’emphase sur la beauté sonore et musicale d’un chant intime qui a le grand avantage de permettre un échange hors du monde sans pour autant avoir à en sortir. Un peu comme si Porumboiu souhaitait pointer l’idée que ce dont on a aujourd’hui besoin est de retrouver une sphère privée, une façon d’être avec l’autre dans la confidentialité.
La grande force des Siffleurs est justement d’exposer la façon dont un individu peut se retrouver littéralement paralysé par une surveillance constante, réelle ou pressentie, technologique policière ou mafieuse. Caméras cachées ou téléphones sous écoute, si ce n’est que la police peut être à vos trousses, Porumboiu dresse le portrait d’un micro contrôle social d’une sournoiserie crasse apte à restreindre l’action au point de faire de quelqu’un le simple spectateur de sa propre vie, parfois même sans en avoir conscience. Si le film s’ouvre avec la mémorable pièce The Passenger d’Iggy Pop, c’est pour souligner que Cristi, protagoniste principal du film, n’aura qu’un rôle de passager, et ce, malgré la participation active qu’il tente d’avoir au sein de la rocambolesque histoire de gangsters dans laquelle il finira coincé entre ses collègues de la police et le groupe de mafieux. Il n’est pas anodin qu’il soit le dernier personnage formellement présenté à l’aide d’un intertitre, alors que les événements du film ont déjà diminué ses forces, formalisant son rôle d’observateur.
Le spectateur est aussi passagé d’un film dont les chamboulements incessants d’alliance deviendraient presque ridicules s’il n’était de la maîtrise de l’enchaînement dont Porumboiu fait preuve. Parsemée d’analepses explicatives, la première partie laisse ensuite place à une alternance entre les péripéties de Gilda et Cristi. À l’aide de ces deux modalités d’allers-retours qu’il maîtrise à merveille, Porumboiu met en place un rythme fluide capable de faire rougir tous les amateurs de karaoké dont le chant développe parfois une cadence erratique lorsque la nuit se prolonge.
No 323 – Prophètes de malheur
24 juin 2020
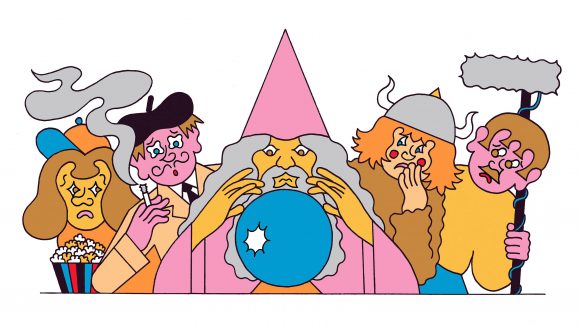
Au jeu des pronostics, l’industrie cinématographique s’est toujours révélée en trompe-la-mort. Depuis l’avènement du son dans les années 1920, cette « mort du cinéma » guette, telle une épée de Damoclès, à la faveur de chaque révolution technologique qui, supposément, viendrait sceller à jamais son sort. Pourtant, Hollywood continue de pondre des Fast & Furious aux deux ans et Vincent Guzzo de projeter des films pro-vie au nom de la liberté d’expression. Cette inclination du cinéma à toujours anticiper sa mort relève sans doute d’un plaisir masochiste, mais le septième art trouve aujourd’hui en la pandémie de COVID-19 un adversaire de taille qui, si elle ne lui assène pas ce coup de grâce tant redouté (ou secrètement désiré), accélérera sans doute, pour reprendre une formule récente de Michel Houellebecq, « certaines mutations en cours ».
Au Québec comme ailleurs, les inquiétudes sont grandes. Tournages suspendus, salles closes jusqu’à nouvel ordre, distributeurs désemparés : le portrait à court et à moyen terme n’a rien de reluisant. Dans l’attente, l’offre se concentre en ligne, les festivals s’adaptent, Netflix, Amazon Prime et les autres s’arrogent une part toujours plus grande du gâteau. Des laissés-pour-compte s’invitent à la fête : les ciné-parcs, réduits jusqu’alors à l’incongruité anachronique, à ranger aux côtés des Walkman jaunes de Sony et de Windows 95, reviennent à l’avant-scène, leurs handicaps devenant tout à coup d’indéniables avantages.
Le problème est complexe, truffé d’impondérables, de « sans précédent » à s’en gratter la barbiche. Car nonobstant la qualité des contenus promotionnés, en la considérant uniquement comme une machine à fric, l’industrie du cinéma continue (pour l’instant) d’être profitable. Et dans quelques cas précis, elle ne l’a jamais autant été, à un point tel qu’il serait difficile de ne pas considérer la salle comme un fâcheux intermédiaire. Le cas de Trolls World Tour est à cet effet probant. Proposé en PVOD (premium video on demand) le 10 avril dernier, après que sa sortie en salle a été suspendue, le film d’animation engrange en trois semaines plus de profits que son prédécesseur, Trolls, en cinq mois d’exploitation « classique ». Profits que la Universal n’aura pas à partager avec les grandes chaînes de salles, comme AMC et Regal aux États-Unis. Les représailles de ces deux dernières entreprises ne se sont pas fait attendre : elles refusent à l’avenir de projeter dans leurs complexes les films du studio proposés simultanément en PVOD.
Les spécificités attrayantes de la salle n’ont plus à être énumérées. Nous les connaissons toutes. Nous n’avons pas à défendre la légitimité de cette expérience exceptionnelle, demeurée la même dans son essence depuis le 28 décembre 1895. Mais, alors que plusieurs salles au Québec sont confrontées à de graves difficultés financières, que les distributeurs parviennent difficilement à faire du profit sur les films qu’ils défendent, que l’arrêt des tournages laisse présager une carence de nouveaux contenus pour les mois à venir, il faut se demander si le système en place sera toujours « viable » dans les mois et années à venir. C’est pour cette raison que nous consacrons 13 pages dans ce numéro à ces questions épineuses, dont les aboutissants n’ont pas fini de nous surprendre.
Nos pensées vont aux amis et amies cinéastes, producteurs et distributeurs, à celles et ceux qui dirigent, programment et coordonnent festivals, salles et cinéclubs. Oui, les critiques sont parfois cyniques. Oui, ils sont bons pour mettre en relief le laid, le négatif, ce qui ne fonctionne pas. Mais ils croient sans l’ombre d’un doute que nous nous reverrons tous très bientôt dans les salles de cinéma. Foi de prophètes de malheur.
JASON BÉLIVEAU
RÉDACTEUR EN CHEF









