En couverture
Séquences à la Berlinale 2022 – Jour 3
14 février 2022
Il faisait beau sur Potsdammer Platz en ce troisième jour de ce festival vacciné, masqué et enrubanné de tests Covid. Le smartphone y est l’instrument de survie puisque les tests quotidiens et les billets électroniques de films, de conférences de presse et d’entrevues s’y entassent pêle-mêle dans les boîtes de messages au milieu des pourriels, des pubs en ligne et des confirmations de rendez-vous. Une bibliothèque de Babel à la main, on louvoie bravement entre les interdits et les défenses de passage aux coins de chaque rue. Une Berlinale à nulle autre pareille, certainement. Qu’en restera-t-il dans les mémoires, cela reste à savoir.

Joyau de la jungle
La journée a commencé avec Nana: Before, Now and Then en Compétition, très beau film indonésien de Kamila Andini, réalisatrice balinaise propulsée sur la scène internationale en 2009 par son premier film The Mirror Never Lies. Yuni, son troisième film fut présenté sur la plate-forme du festival de Toronto en 2019. Cette jeune réalisatrice talentueuse offre avec Nana un film très achevé, d’une texture cinématographique raffinée, subtile et d’une grande beauté. Dans l’Indonésie des années 1960, la belle Nana (Happy Salma), qui a perdu son mari et sa famille durant le conflit qui secoua le pays 15 ans plus tôt, s’est remariée avec un homme riche. Malgré l’amour qui la lie à ses enfants, Nana ne peut s’empêcher de penser à son mari disparu sans trace et à son père assassiné, et n’arrive pas à trouver sa place dans son nouveau milieu, tandis que les trompettes du coup d’État du Général Suharto résonnent. Les rêves de son passé hantent ses nuits tandis que Soni, la nouvelle maîtresse de son époux, perturbe ses jours. Mais Soni (Laura Basuki), contre toute attente, ne prouvera pas être une rivale, mais une alliée et une amie. À coups de pinceau léger, Andini déploie une fresque familiale d’une belle subtilité et d’une admirable richesse de composition visuelle. La caméra détaille chaque regard de la superbe actrice et écrivaine Happy Salma, qu’on veut absolument revoir. Un joyau venu des jungles.
La maman face au Président
L’après-guerre allemand fit appel aux travailleurs turcs pour reconstruire l’Allemagne. De ces gästarbeiters (travailleurs invités) beaucoup s’installèrent sans toujours obtenir la citoyenneté. Les enfants nés en Allemagne de parents étrangers doivent encore aujourd’hui faire une demande de citoyenneté à leurs 18 ans. Cette subtilité administrative explique le cas si complexe de Murat Kurnaz dont l’histoire est raconté dans Rabiye Kurnaz vs George W. Bush d’Andreas Dresen, présenté en Compétion. Murat, jeune homme élevé dans une famille turque de Bremen en Allemagne développe, suite aux attentats du 9 septembre 2001, un intense intérêt pour l’Islam, fréquente la mosquée, et part pour le Pakistan où il est arrêté sur des on-dits par les Américains et envoyé à Guantanamo. N’ayant pas fait sa demande de citoyenneté allemande, le gouvernement allemand refuse de s’occuper de son cas. Sa mère, Rabiyé Kurnaz, qui jusque là avait été une mère de famille turque ordinaire, fera tout pour rapatrier son fils de Guantanamo, jusqu’à intenter un procès au Président des États-Unis. Dresen trace jour après jour la galère de la famille Kurnaz, de leur avocat Bernard Docke et particulièrement de sa mère Rabiyé qui se retrouva sous les feux des projecteurs pendant des années. Le cas de Murat illustre très bien la peur et les préjugés des gouvernements face au terrorisme et les incroyables murailles administratives entre l’Allemagne, les États-Unis et la Turquie face aux prisonniers de Guantanamo, qu’ils se renvoient comme une patate chaude. Cela pourra être étouffant d’ennui, c’est au contraire un film riche d’humour, d’émotion et de tendresse. L’actrice allemande Meltem Kaptan offre une admirable performance, touchante et pleine de vie. Deux heures de montagnes russes administratives où on ne s’ennuie pas une seconde. Faut le faire!

Call Jane!!!
États-Unis, 1960. Après que le comité médical (entièrement masculin) d’un hôpital lui ait refusé un avortement destiné à sauver sa vie, Joy Griffin (Elizabeth Banks) prend les choses en mains : elle « appelle Jane ». Jane, c’est un groupe de femmes qui tiennent une opération d’avortement illégale, fondée par Virginia (Sigouney Weaver), une activiste qui n’a pas froid aux yeux. Mais les tarifs sont chers : le médecin exige 600$ par intervention. C’est beaucoup trop pour les femmes pauvres, surtout les Noires qui sont celles qui en ont le plus besoin. Joy commencera à aider le groupe, au point d’assister le médecin. Mais les besoins sont pressants et Joy décide de prendre les choses en main.
Phyllis Nagy, qui avait écrit le scénario du très beau Carol (2015), offre avec ce premier long-métrage de puissants portraits féminins. Elizabeth Banks est brillante en bourgeoise fatiguée de sa condition féminine et Sigourney Weaver joue son rôle d’activiste avec brio. Phyllis Nagy a filmé les scènes d’avortement avec efficacité et intelligence, sans pathos superflu, fixant l’attention sur les visages et la relation patient-médecin plutôt que d’aller dans le gore. Surtout, elle capture la puissance de la collaboration entre femmes. À l’heure où les Républicains sont en train d’effriter le droit à l’avortement dans plus de 20 états aux États-Unis, voici un film plus que nécessaire.
Nonobstant ces bons films, le meilleur moment de la journée a été la conférence de presse de Good Luck to you, Leo Gande avec l’inoubliable Emma Thompson, qui a offert aux photographes une performance déchaînée durant le photo-call et des réponses d’une brillante intelligence durant la conférence de presse. Il faut dire qu’elle joue dans ce film une femme enseignante retraitée qui appelle un jeune escorte masculin pour apprendre de lui le plaisir sexuel. Humour et intelligence au rendez-vous (on en reparle dans quelques jours)!
ANNE-CHRISTINE LORANGER
Séquences à la Berlinale 2022 – Jour 2
12 février 2022

Matin Mexicain
Petit matin de pluie que notre parapluie rose gardait en respect, en route pour Robe of Gems de la mexicaine Natalia López Gallardo. Si le film est une robe de gemmes, c’est une robe en lambeaux et parsemée de gemmes brillantes, certes, mais dépareillées. Au point où nous nous sommes demandé si la réalisatrice elle-même savait où son histoire voulait en venir. Et puis, on se rend compte que le film ne cherche pas tant à raconter un récit linéaire qu’à évoquer une topographie de la violence et de la souffrance qui sévissent au Mexique. Une famille mexicaine aisée reprend possession de la villa rurale de leur mère dans la campagne mexicaine. Ils reprennent contact avec Mari, l’ancienne domestique de la famille, dont la sœur a disparu six mois plus tôt. Mais tous les personnages de cette fresque complexe souffrent de perte et d’abandon, depuis les enfants jusqu’à la chef de police du village, dont le fils fait partie d’une bande de narcos qui kidnappent des gens. Dans une série de tableaux fort bien filmés, la réalisatrice dépeint le quotidien d’un pays marqué par le machisme et la violence lié au trafic d’armes et de drogues. Le plus criant est un travelling à hauteur de ceinture (ou de celui du regard d’un enfant) à travers un poste de police où les familles des personnes disparues cherchent à retracer leurs proches. La robe de gemmes est peut-être celle de ces milliers de personnes qui, comme Mari, tente de survivre à l’insurmontable.
La ligne du jour
De la campagne mexicaine, nous voyageons vers les sommets enneigés de la Suisse avec La ligne d’Ursula Meier qui nous avait donné l’excellent L’enfant d’en haut en 2012 (Prix Alfred-Bauer de la Berlinale 2012). Encore une fois il s’agit d’un drame familial où les rôles de parents et d’enfants sont interchangeables entre les adultes et leur progéniture. Après avoir violemment frappé sa mère lors d’une dispute, Margaret (excellente Stéphanie Blanchoud) une auteure-compositeure-interprète constamment impliquée dans des bagarres, est condamnée pendant trois mois à ne pas pouvoir approcher la résidence familiale à l’intérieur de 100 mètres, sous peine de se retrouver en prison. En vue de protéger Margaret, trop impulsive, sa jeune sœur Marion (Elli Spagnolo) peint une ligne bleue dans un rayon de 100 mètres tout autour de la maison, que Margaret ne doit pas franchir. Les interactions entre les sœurs et leur mère narcissique et égoïste (Valérie Bruni-Tedeschi) s’effectuent autour et à travers cette ligne qui délimite aussi des univers où chacun doit définir les mots famille, sécurité, soutien et parents. Il manque une toute petite touche pour faire de ce film un grand film. Pour l’instant, c’est un beau film qui fait du bien. C’est déjà beaucoup!

La dispute du jour
C’est Wagner, à l’opéra, qui détient la palme de la meilleure et plus longue scène de ménage dans la Walkyrie. Au cinéma, Mike Nichols garde sa médaille d’or avec Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966). On pourrait cependant donner la médaille d’argent à Claire Denis pour Avec amour et acharnement qui réunit à l’écran Juliette Binoche et Vincent Lindon incarnant un couple heureux qu’un ancien amour va venir troubler. Alors que Sara (Binoche) et Jean (Lindon) reviennent de vacances, leur passé viendra tous deux les hanter. Sara revoit pour la première fois François (Grégoire Colin), son ancien amour qui était aussi le meilleur ami de Jean. Jean, quant à lui, éprouve des difficultés de communication avec son fils métis qui a des problèmes à l’école, avec sa mère et aussi avec son passé de joueur de rugby blessé qui a échoué en prison. Puis, François offre à Jean de venir travailler pour lui. Ce sera l’occasion pour Sara de revoir celui qu’elle avait tant aimé.
Claire Denis nous tient ici par la main et nous force à assister à la lente détérioration d’un couple, pas à pas. C’est à la fois désagréable et troublant d’observer en très gros plan des gens qui mentent en croyant être sincères, qui se fuient prétendant se toucher et qui se murent de l’autre tout en cherchant à ne pas blesser. Le travail de Juliette Binoche ici est remarquable, posant à Jean des questions innocentes avec le léger sourire aimable et figé de la femme avec un agenda caché qui, soudainement, a des éclairs de sincérité. Vincent Lindon incarne fort bien un homme amoureux qui ne veut pas perdre celle qu’il aime, mais aussi un homme abîmé qui sent le besoin de refaire sa vie et de se prouver à lui-même. Reste qu’aucune querelle de couple n’est plaisante. Mais cela peut être fascinant. Et révélateur.
Crier la beauté du monde
Le chêne est l’arbre qui, et de loin, abrite l’écosystème le plus développé et le plus complexe de l’hémisphère nord. Au sein de leur film muet baptisé Le chêne, Laurent Charbonnier et Michel Seydoux nous détaillent cet écosystème dans un sublime luxe d’image ravissante, touchante, amusantes ou simplement sublimes de beauté, en plus de nous faire découvrir la vie animale et végétale qui se niche autour d’un chêne. On y voit plus de 40 espèces animales qui croient, se reproduisent et parfois meurent au cours des saisons, sur une riche trame sonore. Un film muet qui crie la merveille du monde. 1h25 de bonheur.
ANNE-CHRISTINE LORANGER
Séquences à la Berlinale 2022 – Jour 1
11 février 2022

Avec 1600 membres de la presse présents (au lieu des 5000 habituels), et alors que les membres du EFM (European Film Market) sont condamnés à visionner les films en ligne, la Berlinale nous semblait un peu vide ce matin à notre arrivée sur Potsdamer Platz, la célèbre place berlinoise construite sur les ruines du Mur. Point de foule de journalistes et distributeurs se massant pour pénétrer dans les salles et foin des joyeux tumultes de retrouvailles et d’échanges qui précèdent habituellement les conférences de presse. Alors qu’avant le badge de presse suffisait pour entrer, on doit réserver ses billets en ligne pour toutes les projections et toutes les conférences remplies à 50%. Places attitrées, ne vous en déplaise. Si cela a l’avantage d’offrir un siège supplémentaire pour disposer ses petites affaires, n’empêche que tout cet espace donne une impression de tristesse. Souhaitons que la nature humaine, qui a horreur du vide, sache le combler avec de belles expériences de cinéma. Le jury international semblait bien prêt à le faire, les Karim Ainouz (Brésil, Algérie), Said Ben Said (France, Tunisie), Anna Zohra Berrached (Allemagne), Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), Ryûsuke Hamaguchi (Japon) et Connie Nelsen (Danemark), présidés par nul autre que le cinéaste M. Night Shyamalan (USA), ont allègrement répondu aux journalistes et partagé avec joie leur premier grand moment de cinéma (grâce à une question de Séquences, hum!)
Parlant de cinéma, le film d’ouverture Peter von Kant de Francois Ozon, présenté en Compétition, nous a une nouvelle fois permis d’apprécier la diversité du talent de ce cinéaste inclassable, qui touche à tous les styles en se trompant rarement. Le film réinvente Les larmes amères de Petra von Kant de Rainer Werner Fassbinder, qui percuta les écrans pour la première fois en 1972… lors de la Berlinale! Ozon transforme cependant le huis clos entre femmes de Fassbinder. En lieu et place de Petra, une dessinatrice de mode lesbienne, de sa cousine Sidonie, de son amante Karin ainsi que de Marlène son assistante dans un luxueux appartement de Cologne, Ozon met en place des personnages masculins et excorie son message politique. La filiforme Petra devient ainsi Peter (Denis Menochet), un cinéaste de talent, bedonnant et abusif, Marlène, l’assistante souffre-douleur qui ne prononce pas un mot de tout le film est maintenant Karl (Stéphane Crépon), un jeune dont la minceur contraste avec le pesant Peter. Sidonie (Isabelle Adjani) est une actrice rendue célèbre vingt plus tôt par Peter. Et Karin devient Amir, un splendide jeune homme dont Peter tombe éperdument amoureux. Jeux de pouvoir, rapports de force, règlements de compte, sensualité de l’image et richesse des coloris, beaucoup de ce qui faisait la force du film de Fassbinder est présent dans le film d’Ozon. Outre le message politique, il y manque cependant la lenteur de la caméra de Fassbinder, qui semblait flotter à travers les personnages et donnait une touche d’autant plus lancinante aux échanges brutaux entre les femmes que ses images constituaient un régal pour les yeux. Reste que le Peter de Denis Ménochet, qui a le physique de Fassbinder lui-même, est déchirant dans sa passion pour Amir qui lui fera verser, lui aussi, des larmes amères. Quand à la Sidonie interprétée par une Isabelle Adjani sérieusement amincie et dont le visage un peu figé (botox!) garde tout de même la qualité d’expression de son magnifique regard, elle est cette diva qui a souffert aux mains d’un réalisateur et qui règle ses comptes avec lui, en toute amitié malsaine. Elle est théâtrale et subtile, innocente et secrètement farouche. Un bon rôle pour elle.
Rimini, le film de l’Autrichien Ulrich Seidl, porte sur un chanteur de charme sur le retour (Michael Thomas), qui divertit les seniors en visite d’hiver dans les hôtels quasi vides et enneigés de Rimini en Italie. Les temps sont durs pour le chanteur vieillissant et il doit louer sa maison à des fans tout en se logeant dans des hôtels vides. Il s’envoit également en l’air avec les soixantenaires payantes du coin. Le film revient à un ancien sujet de Seidl dans sa série Paradis : Amour où il explorait la vie de cinquantenaires qui se rendent dans des lieux de vacances au Sénégal pour trouver des hommes africains prêts à leur faire l’amour contre rétribution financière. Seidl revient au sexe payant dans des lieux de villégiature, mais cette fois-ci il nous montre la vie solitaire et somme toute assez triste d’une ancienne vedette de seconde catégorie, auquel il ne reste que peu de choses dans la vie, sinon ses costumes de scène, l’amour de ses vieilles fans et l’alcool. Mais soudain, sa fille fait son apparition et exige l’héritage de sa mère.

La section Panorama nous a offert hier Viens je t’emmène d’Alain Guiraudie, une comédie dramatique filmée à Clermont-Ferrand (France) portant sur Mérédic (Jean-Charles Clichet), un jeune homme tombé amoureux d’une prostituée mariée et qui se retrouve à héberger Salim (Illiès Kadri), un jeune sans-abri origine arabe qui a fui sa famille de Lyon. Tout cela alors que Clermont-Ferrant vient de vivre sa première attaque terroriste. La présence de plus plus insistante de Salim s’effectue au grand dam de certains voisins de son immeuble et avec l’approbation de certains autres. Guiraudie s’amuse à déconstruire les clichés et à confronter bonnes intentions, bêtise malsaine et peur du Jihad. Il confronte son public et le force à examiner ses préjugés à travers une oeuvre touchante et originale.
ANNE-CHRISTINE LORANGER
No 329 – Travelling avant sur le Château Frontenac, en contre-jour
11 janvier 2022

Laissez-moi vous parler de Québec. Ces temps-ci, la région de la Capitale-Nationale fait la manchette, mais pour des raisons qui sont très éloignées du cinéma (ceci étant dit, je verrais bien dans quelques années un film sur le troisième lien dans l’esprit de Réjeanne Padovani de Denys Arcand).
Une petite mise en contexte s’impose, qui vous fera comprendre qu’il est ici question — à peine, à peine — de chauvinisme pleinement assumé. Bien que la majorité de son équipe habite Montréal, Séquences est une revue dont les bureaux sont situés dans l’une des plus vénérables et anciennes institutions de Québec. Pour ma part, j’habite les divers quartiers de son arrondissement La Cité-Limoilou depuis une quinzaine d’années.
Québec est une ville carte postale, c’est bien connu, mais elle est étrangement peu présente sur les grands écrans. Elle demeure néanmoins le décor d’un grand classique du cinéma, I Confess d’Alfred Hitchcock (1953), accueilli tièdement à sa sortie en salle aux États-Unis, encensé quelques mois plus tard en France, notamment par Jacques Rivette dans Les cahiers du cinéma. Le synopsis, tout simple, est diablement efficace : le père Logan (Montgomery Clift) choisit de taire l’identité d’un tueur, étant lié à celui-ci par le secret de la confession. Par subterfuge, l’assassin portait une soutane la nuit du crime. Logan devient ainsi le principal suspect de l’affaire. Mais cet homme de Dieu, d’apparence noble, est loin d’être sans reproche.
Nous sommes en terrain connu : le film est un exemple parfait du concept de transfert de culpabilité qui consume le cinéaste (Strangers on Train et The Wrong Man étant deux autres exemples probants). Son utilisation de l’architecture particulière du Vieux-Québec est conséquente, les rues étroites et tortueuses du quartier formant un dédale escherien où toute ligne de fuite se bute à un mur. Aucune issue n’est possible pour le père Logan. Nous baignons en plein cauchemar expressionniste. Pour l’habitant.e de Québec, un jeu s’ajoute à celui qu’Alfred orchestre pour notre plaisir de cinéphile : celui qui consiste tracer une carte fidèle des lieux défilant à l’écran, alors que, bien entendu, l’espace filmique est ici constitué d’un amalgame de décors bigarrés et éloignés les uns des autres.
Hitchcock a plus tard répudié I Confess pour son manque d’humour. Bien qu’il soit effectivement l’un des films les plus arides du maître du suspense, il concentre magnifiquement ses obsessions et se termine sur une scène iconique à l’intérieur du Château Frontenac. Cette comète a laissé une trace indélébile sur la ville, au point qu’un p’tit gars d’ici, et pas des moindres, en a fait le point de départ d’un premier film qui, j’oserais dire, le surpasse en tout point. Le confessionnal de Robert Lepage a réussi à extirper toute la québécitude du film de la Warner Bros. : l’influence de l’Église sur les ménages d’alors, la complicité du gouvernement duplessiste, la culpabilité typiquement catholique. Ce récit parallèle, campé dans les années 1950 et 1980, au-delà des tours de passe-passe chers à Lepage, forme une réflexion fascinante sur la façon dont les Québécois.e.s se perçoivent dans l’œil de « l’Autre ». Présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 1995 (accompagné d’Eldorado de Charles Binamé), succès critique incontestable, déjà qualifié de classique de notre cinéma national à sa sortie en salle, il est la plus grande réussite cinématographique tournée à Québec.
Cut to un demi-siècle plus tard. Québec continue de se faire timide sur les grands écrans. Sa dernière apparition notable à l’international est dans Catch Me If You Can de Steven Spielberg (2002), où la place Royale se substitue à Montrichard en France le temps d’une scène inoubliable opposant Tom Hanks et Leonardo DiCaprio. Plus récemment, on est venu y tourner des miniséries sud-coréenne (Goblin) et américaine (Barkskins). Même dans le cadre de productions québécoises, elle se fait rare. Depuis Les Plouffede Gilles Carle en 1981, production pharaonique d’une incontestable qualité, on pourrait noter Tout ce que tu possèdes de Bernard Émond (2012), tourné dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, et quelques scènes des films de la série 1981 de Ricardo Trogi, originaire du coin.
Plus récemment, le cinéaste de Québec Samuel Matteau a réussi, avec son premier long métrage Ailleurs (2017), à extirper notre ville de ses poncifs et d’en faire une entité étrange et mystérieuse, nourrie par son histoire et son architecture unique. Rien que pour ce pari relevé, le film mérite d’être vu. Mais autrement, Québec est encore à réfléchir cinématographiquement. Les possibilités sont infinies.
JASON BÉLIVEAU — RÉDACTEUR EN CHEF
Red Rocket
17 décembre 2021
On drague, on branche, toi-même tu sais pourquoi
Maxime Labrecque

Bye Bye Bye. Vernis pop, clinquant. Mais comme recouvert d’une poussière grasse. La chanson du groupe NSYNC donne le ton à ce film improbable et pourtant si réel, où l’écho optimiste d’un boys band d’antan ne fait que rappeler la gloire du « ça a été ». Après le sublime The Florida Project, Sean Baker décide de rester dans les États du Sud mais en troquant la Floride pour le Texas. Chez Baker, les lieux façonnent les personnages et instaurent dès les premiers instants un imaginaire fort, comme cette unique maison délabrée entourée de raffineries où débarque Mikey. Malgré l’aura de loser qui l’accompagne partout où il va, Mikey possède un je-ne-sais-quoi de magnétique, un sex appeal tape-à-l’œil fané qui provoque, chez celles et ceux qu’il subjugue, une certaine fascination. Beau parleur, éternel adolescent dont la gloire est depuis longtemps ensevelie sous une couche de mensonges et de mauvaises décisions, il ne peut — ou ne veut — s’ajuster au monde adulte, rêvant de glitter et de lube et d’une jeune rouquine qui vend des beignes. Narcissiste, individualiste, hyperactif. Une caricature ? On voudrait le croire, mais cette figure polarisante qu’on aime et qu’on déteste est, en fin de compte, criante de vérité; un archétype nourri aux clichés dès la plus tendre enfance, aux opinions arrêtées, au comportement provoquant d’innombrables dommages collatéraux.
Voilà que le titre semble prendre ici tout son sens. D’aucuns pourraient y voir une métaphore de la personnalité incandescente, de l’énergie hyperactive de Mikey Saber, ex-vedette de films pour adultes incarnée ici par l’infatigable Simon Rex. Soit. Mais les plus fins, ou tout simplement les plus bilingues d’entre nous, qui maîtrisent peut-être — non sans une certaine fierté — quelques expressions de slang, savent vraiment ce dont il s’agit. Oh ! oui, ils savent. Ceux-là mêmes qui ont déjà un sourire en coin en ayant lu le titre sans même en connaître le propos. Car oui, ce red rocket désigne, purement et simplement, une érection canine. Nul besoin de verser dans la surinterprétation. Une bête réaction physique basée sur le désir qui, bien souvent pour le pire, outrepasse, contourne la raison. Tout est dit. Mais une question demeure : aurait-on assisté au grand retour de la prothèse pénienne de Mark Wahlberg près de 25 ans après Boogie Nights ? En fait, probablement pas. Car, en fouillant ici et là, on découvre assez facilement que Simon Rex est le parfait exemple d’une réalité qui dépasse la fiction. D’abord acteur de films pour adultes, il devient par la suite mannequin puis VJ à MTV et rappeur sous le pseudonyme Dirt Nasty (évidemment). Bien qu’il ait incarné des rôles très secondaires dans quelques films comme Scary Movie 3, Rex tient, dans Red Rocket, son premier grand rôle au cinéma où il étale toute son authenticité, son énergie brute et son sourire niais à vélo.
Mikey entretient un flirt risqué avec Strawberry, 17 ans, qui culmine dans une finale nimbée de teintes rose et jaune, symbole d’un avenir meilleur telle cette fuite à Disney World à la fin de The Florida Project. Mais cette finale bonbon est-elle bien réelle ou n’est-ce qu’un bref moment de grâce avant une débâcle qu’on imagine inévitable ? Ou est-ce une manière de renvoyer ce fantasme résolument cliché au visage de tous ces hommes en crise, si prévisibles et petits, qui gonflent leur ego à l’aide des pires artifices ? Au-delà du décor et de Mikey, c’est la richesse des personnages secondaires — qui incarnent le seuil entre naturalisme et caricature — qui fait la force du film. Lexi (Bree Elrod) et sa mère qui fument comme les raffineries qui les entourent, la dealeuse vétérane et sa fille qui ne se laisse pas impressionner, le voisin mytho qui provoque un carambolage; des personnages d’une banalité déconcertante et, pourtant, plus grands que nature, vrais et crus, sortis d’un vox pop sur une chaîne locale de la Fox. Il y a là un potentiel narratif inépuisable que Baker exploite avec une efficacité redoutable.
Chose certaine, Sean Baker trouverait sa place dans un hypothétique pique-nique avec les frères Safdie, Andrea Arnold et Harmony Korine.
Festif.
Films à voir, ou pas, au 27e Festival Cinémania
1er novembre 2021
2-14 novembre en salle > 2-21 novembre en ligne
Daniel Racine

Festival dédié aux films francophones depuis plus de 25 ans, né avant son alter ego français d’Angoulême, Cinémania prouve année après année sa pertinence et son importance dans notre écosystème cinématographique montréalais. Nous sommes loin de l’époque où le cinéma français occupait une place de choix sur nos écrans, c’est pourquoi la cuvée annuelle de Cinémania permet de combler l’absence ou la présence furtive d’œuvres fortes aux signatures identifiables par les cinéphiles, en plus de films grand public qui n’auront jamais la chance d’être distribués sur notre territoire.
Voici donc un survol de quelques films qui seront disponibles en ligne et/ou en salle dans les prochaines semaines du mois de novembre durant Cinémania.
5ème set de Quentin Reynaud
À voir en ligne seulement (pendant 48 heures)

Il y a toujours un danger à mettre en scène une réalité fictive ancrée dans le monde du sport. Un peu comme les univers de la musique ou de la danse, la difficulté réside dans la crédibilité de la performance physique de l’acteur ou de l’actrice : allons-nous y croire! Pour un premier long métrage réalisé en solo, le cinéaste Quentin Reynaud s’en tire plutôt bien, grâce aux impressionnantes prouesses d’Alex Lutz (que nous avions découvert dans Guy en 2017, rôle pour lequel il a reçu un César). L’acteur a su devenir un joueur vieillissant d’un bon niveau, malgré que Lutz n’eût jamais touché à une raquette de sa vie avant le tournage. Bien que ces scènes réussissent à être parfois déchirantes, entre les souffrances du corps qui s’accrochent et le questionnement intérieur du personnage, 5ème set s’étire inutilement.
Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit
À voir en ligne et en salle

Aucune étiquette ne colle au cinéaste Samuel Benchetrit. Après, entre autres, Janis et John, J’aurai voulu être un gangster et son précédent intitulé simplement Chien, celui qui est aussi auteur et dramaturge semble enfin trouver dans Cette musique ne joue pour personne l’équilibre idéal entre son humour décalé et une certaine humanité. Quel bonheur de voir JoeyStarr complice avec Bouli Lanners, le monolithe Gustave Kervern prendre vie aux côtés de la touchante Vanessa Paradis, et le duo Ramzy Bedia et François Damiens s’improviser poètes. Même si cette histoire de petits parias piétine un peu, de nombreuses séquences sont d’une redoutables efficacités, laissant place à des rires francs et un sentiment de perdre des connaissances sympathiques avec lesquels nous aurions poursuivies encore plusieurs minutes, ou quelques épisodes de plus.
France de Bruno Dumont
À voir en salle seulement

Léa Seydoux est partout cet automne : elle revient aux côtés de James Bond, elle est la muse de Benicio del Toro dans le nouveau Wes Anderson, et la voilà reine des ondes chez Bruno Dumont. L’ancien professeur de philosophie nous propose un regard cinglant sur le milieu des vedettes de l’information, et il a compris que Seydoux avait exactement ce qu’il cherchait pour ne pas tomber dans la facilité, soit l’aura d’une star et la fragilité d’une femme incomprise. Usant du malaise comme seul lui sait le faire, Bruno Dumont fait de France un puissant plaidoyer contre l’hypocrisie des médias de masse. France est une farce nécessaire à notre époque surmédiatisée et Bruno Dumont demeure le plus fascinant des réalisateurs français de notre époque.
L’événement d’Audrey Diwan
À voir en ligne et en salle

Lion d’Or amplement mérité à la dernière Mostra de Venise, L’événement d’Audrey Diwan fait écho au film Never Rarely Sometimes Always de l’américaine Eliza Hittman sorti l’an passé. Difficile d’admettre qu’il y a presque soixante ans d’écart entre ces deux époques fictives proches du réel, même si le premier se situe en France et le second aux États-Unis. Cela montre à quel point les femmes ne peuvent rien tenir pour acquis. Fortement influencé par la méthode des frères Dardenne, Audrey Diwan ne quitte jamais sa protagoniste et comme spectateur nous sommes carrément agrippés à la peau de la comédienne Anamaria Vartolomei, qui n’est rien de moins que formidable. Un film coup de poing avec certaines scènes quasi insoutenables, mais que tout le monde devrait voir pour bien comprendre les nombreux enjeux entourant l’avortement.
La fracture de Catherine Corsini
À voir en salle seulement

Définitivement le film le plus politique de la carrière de Catherine Corsini, La fracture raconte une nuit mouvementée (c’est un euphémisme) dans un hôpital parisien, un soir de manifestation des gilets jaunes. Si la cinéaste s’en tire bien dans son propos général, la surenchère des drames finit par nous faire décrocher. Toutefois, impossible de rester de glace devant l’intensité du jeu de Valéria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï et Aissatou Diallo Sagna, tous au sommet de leur art, passant avec aisance entre les différentes émotions que leurs personnages traverseront. Et pour qu’une réalisatrice habituée aux histoires d’amour prenne de front un sujet aussi brûlant, c’est qu’il y a réellement péril en la demeure.
La terre des hommes de Naël Marandin
À voir en ligne seulement (pendant 48 heures)

Retenez le nom de Diane Rouxel. Dans La terre des hommes, cette jeune actrice aux épaules fragiles montre avec force et nuance tous les sentiments qu’une femme peut traverser dans un monde dominé par les hommes. Le tour de force de Diane Rouxel, c’est de ne jamais tomber uniquement dans le rôle de la victime. Aidé du doigté du réalisateur Naël Marandin, le personnage porte bien le nom de Constance, car jamais la flamme en elle ne s’éteindra, peu importe les obstacles qu’elle devra affronter. Après l’excellent Petit paysan d’Hubert Charuel, voici un autre drame en milieu agricole qui nous prend à la gorge et durant lequel le spectateur ne craindra pas de se salir les yeux, à défaut des mains.
Médecin de nuit d’Elie Wajeman
À voir en ligne et en salle

Après Alyah et Les anarchistes, Elie Wajeman nous offre avec Médecin de nuit son film le plus maîtrisé, à la fois noir et plein de bonnes intentions. Une lente descente aux enfers, portée par un Vincent Macaigne magnétique qui tente par tous les moyens de ralentir sa chute. En voulant aider un peu trop les toxicomanes qu’il côtoie dans son travail, cet homme déchiré arrivera à l’heure des choix. Wajeman se la joue Scorsese, gardant bien en mains tous les aspects de son drame à la première personne. Une sombre pépite qui nous habite longtemps après le générique de fin.
Suprêmes d’Audrey Estrougo
À voir en salle seulement

JoeyStarr et Kool Shen, les deux porte-étendards du groupe rap français NTM, ont désormais leur film biographique. La réalisatrice Audrey Estrougo revient aux balbutiements de ce duo issu de la Seine-St-Denis, en suivant les codes du genre à la lettre, peut-être un peu trop. Mais les jeunes Théo Christine et Sandor Funtek sont tellement sincères et dynamiques dans leur performance, que nous nous laissons transporter par leur musique et nous suivons avec intérêt leur ascension jusqu’à leur premier concert au Zénith. Malgré le manque d’originalité, la formule est efficace et pourra satisfaire les fans comme les curieux.
No 328 – Se passer de commentaires
27 septembre 2021
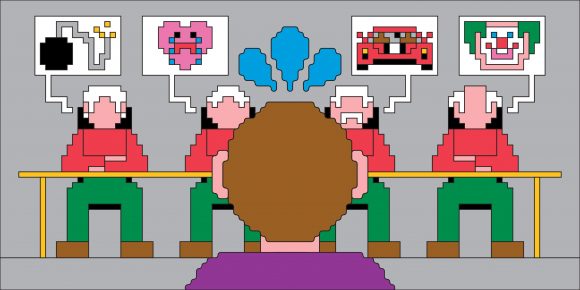
En guise de couperet, difficile d’imaginer phrase plus équivoque :
« Le jury a questionné la place de l’humour dans le thème de la quête identitaire d’un personnage métissé [sic]. »
Cette remarque, cryptique s’il en est, a été adressée récemment à Nicolas Krief, coscénariste de Jusqu’au déclin et réalisateur des courts métrages Skynet et Opération Carcajou, en réponse à projet de court métrage déposé au Conseil des arts et des lettres du Québec. Krief, né d’un père tunisien et d’une mère québécoise (donc métis, faut-il bêtement le souligner), l’a partagée publiquement en ligne, se contentant d’y ajouter un succinct « Y a encore du chemin à faire les potes, beaucoup de chemin ».
Notez que le jury n’a pas mis en doute l’humour en soi (est-ce drôle ?), mais la place de l’humour (peut-on/doit-on en rire ?) dans la quête identitaire d’un personnage métis. Le terme est galvaudé, mais il faut se prêter à d’étonnantes circonvolutions mentales pour ne pas considérer comme problématique cette position qui — et je cite à nouveau Krief, cette fois-ci dans une conversation que nous avons eue en privé — « invalide la démarche de l’auteur et se trouve à l’opposé des mesures que devraient entreprendre les institutions de financement qui veulent diversifier notre cinéma. Le danger avec un tel commentaire, c’est qu’il peut décourager, par exemple, une ou un cinéaste de la diversité de soumettre à nouveau son projet, ou même de poursuivre sa carrière artistique. » Cette question mériterait à elle seule tout un texte, mais je ne me sens pas assez outillé pour la développer adéquatement. Elle illustre tout de même dans le particulier un sac de nœuds que tous les cinéastes québécois devront tôt ou tard se coltiner : le retour des comités d’évaluation sur leurs projets de film.
Sans aucune prétention statistique, j’ai sondé il y a quelques semaines mon entourage dans le milieu : « Quelles sont les remarques les plus absurdes que vous avez reçues de la part de la SODEC, du CALQ, de Téléfilm Canada, par rapport à un scénario déposé ? » En quelques minutes, j’étais enseveli sous des dizaines de témoignages. Quelques critiques rapportées me sont apparues anodines, dans certains cas défendables. La majorité m’a rendu perplexe. Une ou deux m’ont carrément mise en colère. Par acquit de conscience, je n’en partagerai aucune ici, mais leur accumulation m’a rapidement démontré l’absurdité bureaucratique qui sous-tend toute évaluation d’œuvres artistiques (le cœur) par des entreprises dites culturelles (les poches).
L’opposition est facile : les pauvres créateurs incompris d’un côté, les méchants fonctionnaires de l’autre. Mais comment ne pas être le moindrement en colère de voir un scénario sur lequel on a planché durant des mois prendre le dalot pour des raisons en apparence insensées ? Vous me direz que si leur scénario avait été accepté, jamais ces artistes ils ne se plaindraient. Ce n’est pas faux. Et quel cinéaste établi n’a pas des tiroirs qui débordent de films avortés ? Stanley Kubrick n’a-t-il jamais pu tourner sa biographie rêvée de Napoléon ? Au Québec, Robert Morin vient de publier aux éditions Somme toute un recueil de trois scénarios tablettés (Scénarios refusés, notre recension en p. 50). Au moment de la mort en août dernier de Rock Demers, Radio-Canada nous rappelait dans sa notice nécrologique que le plus grand regret du créateur des Contes pour tous a été de ne pouvoir mettre à terme, à la fin de sa vie, un projet de film mettant en vedette un personnage autochtone. La SODEC avait refusé de le financer.
Il demeure facile de lancer des pierres sur des cibles qui ne peuvent se défendre, de juger a posteriori de « mauvaises » décisions, de sermonner des comités d’avoir dormi, par exemple, sur un talent comme celui de Myriam Verreault, qui a dû attendre dix ans après À l’ouest de Pluton pour enfin réaliser Kuessipan. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous dans les bottines de celleux qui siègent sur ces comités maudits, de ces jurés qui doivent lire attentivement, trier, soupeser, juger, trancher. Épineux, non ? J’irais même jusqu’à avancer qu’il n’y a pas de poste plus ingrat dans toute notre industrie. Cette autorité césarienne qui, sur un dix sous, peut assurer ou mettre fin à la carrière d’un cinéaste, peu doivent l’accueillir sans être conscients de son poids, des responsabilités qu’elle incombe.
Aucun système n’est parfait. Pour cela, il faudrait financer tout le monde sans distinction. Instaurer un système par ordre alphabétique, un tirage au sort. Une chasse aux œufs de Pâques, tiens. Quoique, nous ne sommes déjà plus très loin de la réalité. Mais admettre les failles inhérentes à la présente façon de procéder ne signifie pas pour autant accepter sans broncher les aberrations comme celle qu’a dû essuyer Nicolas Krief, nonobstant les qualités intrinsèques de son projet de film.
Dans ces cas, mieux vaut encore se passer de commentaires.
JASON BÉLIVEAU — RÉDACTEUR EN CHEF







