Festivals
Séquences à Dok Leipzig 2021
11 novembre 2021
Les multiples formes du documentaire
Jérôme Michaud
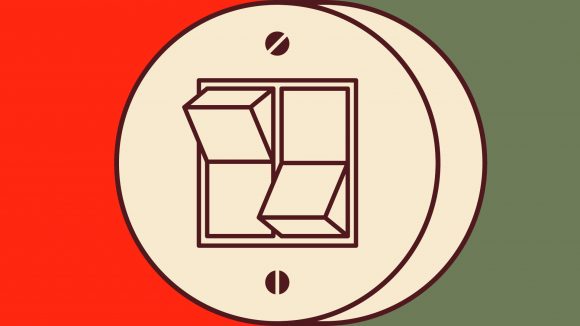
À la fin octobre, Dok Leipzig revenait pour sa 64e édition et sa sélection réservait, comme chaque année, quelques perles. On y retrouvait notamment le très attendu A Night of Knowing Nothing, gagnant de l’Œil d’or du meilleur documentaire au dernier Festival de Cannes. Le film se retrouvera également aux RIDM, pour une représentation en salle seulement, le 17 novembre.

Si on ne parle jamais de chef-d’œuvre dans le cas des documentaires, c’est plus par habitude que parce que cette terminologie ne s’y appliquerait pas. A Night of Knowing Nothing, premier long métrage de la cinéaste indienne Payal Kapadia, est une œuvre majeure qui se sert de sa lenteur d’une manière redoutable. Sa réalisatrice a entièrement compris la force des contrastes au cinéma, alors qu’elle parvient à rendre absolument révoltantes des images de brutalité policière, et ce, parce qu’elle les place savamment dans des segments d’une douceur prononcée.
Depuis 2015, les manifestations étudiantes font rage en Inde. Elles sont menées par un mouvement de gauche anti-caste qui est, notamment, contre la mise en place de personnes proches du pouvoir dans des postes d’influence des universités et contre la hausse des frais de scolarité. Kapadia, tout en renseignant son spectateur, propose de passer par des lettres d’amour fictives et une narration écrite pour déployer son film d’une belle hybridité : entre fiction et documentaire, entre film expérimental et archives. La cinéaste fait preuve d’une maîtrise de la composition assez rare et complètement envoûtante de laquelle émanent beauté, nostalgie et lumière, et ce, malgré la sombre répression dépeinte.
En donnant l’exemple d’une série d’actes violents qu’elle répertorie chronologiquement par l’intermédiaire d’archives journalistiques, elle dresse le constat que nous avons perdu beaucoup de sensibilité face à la souffrance d’autrui : une tragédie n’attend plus l’autre dans un monde médiatiquement connecté. À l’aide de sa démarche magnifiquement élaborée et profondément sentie, Kapadia parvient de belle manière, l’espace d’un instant, à nous redonner cette affectivité perdue, ce qui est loin d’être anodin!
Dans un geste qui comprend une certaine similitude, Republic of Silence de Diana El Jeiroudi est l’un des rares documentaires qui parvient à faire ressentir avec autant de force le parcours dans la durée d’exilés syriens. Ce tour de force est rendu possible parce que la cinéaste a documenté depuis plus d’une décennie sa propre histoire et celles de ses proches.
Portraits intimes, certes, mais pas que, puisque la première moitié du film, plus spécifiquement que la deuxième, incorpore de nombreuses images d’archives qui permettent de restituer une partie de la grande Histoire. La construction narrative du film est définitivement d’une grande richesse. Même s’il y a une forme de chronologie temporelle, l’œuvre fait plusieurs allers-retours habiles entre présent et passé, ce qui permet de rendre plus tangible le traumatisme que portent toujours en mémoire les protagonistes même plusieurs décennies après les faits.
La cinéaste articule deux moments fort différents qu’elle représente avec une belle honnêteté. Les années en Syrie sont marquées par une militance active qui laisse progressivement place à des années plus calmes, alors qu’on constate un lent apaisement en Allemagne. L’éloignement physique finit par créer une distance avec la guerre civile syrienne et El Jeiroudi en livre alors moins l’actualité, ce qui pourra donner l’impression à certains que le film s’égare, puisque cette bifurcation contraste avec la première partie. Republic of Silence s’intéresse définitivement plus aux humains derrière les horreurs qu’à l’histoire elle-même et c’est dans la proximité et l’intimité que la cinéaste ouvre qu’elle accroche viscéralement l’affectivité de son spectateur.
Murilo Salles, dans A Bay, se sert d’une approche qu’on pourrait dire aux antipodes des deux précédentes. Il convoque notre intellect pour rapprocher et donner consistance aux fragments librement détachés qu’il offre de la Baie de Guanabara, étendue d’eau qui borde Rio de Janeiro à l’est. Le cinéaste brésilien enchaîne huit segments sans liens évidents entre eux dans lesquels il dresse des portraits assez minimaux et allusifs de riverains vivant dans la précarité et devant cumuler les petits emplois pour survivre.

Tout cela pourrait être assez banal si Salles n’avait réussi à toujours faire signifier plus que ce qu’on voit au premier regard dans ses images. Dans A Bay, une opération de chargement de minerais dans un navire s’accompagne d’un bruit de tonnerre tonitruant, un hydravion de fortune est patiemment construit, en bonne partie grâce à des canettes de boissons gazeuses, la tête d’un cheval est filmée de près alors qu’il galope sur un remix psychotique de Carry That Weight des Beatles, etc. À l’aide d’une attention particulière accordée à l’alliage son et image, il travaille par contraste, juxtaposition et accumulation, parfois de façon assez appuyée. On pourrait alors lui reprocher de manquer de subtilité, mais il faut surtout y voir un désir de virulence qui dénote une lassitude devant les immenses inégalités sociales qui perdurent à Rio et en bordure de la Baie de Guanabara.
Par le biais d’approches assez différentes, mais toujours foncièrement cinématographiques, les trois cinéastes parviennent à stimuler le spectateur bien au-delà du sujet traité. Le documentaire contemporain ne cesse de remettre en cause sa forme classique et cela ne peut que légitimement réjouir ceux qui éprouvent une lassitude devant les tendances conformistes de la fiction.







