Articles récents
Red Rocket
17 décembre 2021
On drague, on branche, toi-même tu sais pourquoi
Maxime Labrecque

Bye Bye Bye. Vernis pop, clinquant. Mais comme recouvert d’une poussière grasse. La chanson du groupe NSYNC donne le ton à ce film improbable et pourtant si réel, où l’écho optimiste d’un boys band d’antan ne fait que rappeler la gloire du « ça a été ». Après le sublime The Florida Project, Sean Baker décide de rester dans les États du Sud mais en troquant la Floride pour le Texas. Chez Baker, les lieux façonnent les personnages et instaurent dès les premiers instants un imaginaire fort, comme cette unique maison délabrée entourée de raffineries où débarque Mikey. Malgré l’aura de loser qui l’accompagne partout où il va, Mikey possède un je-ne-sais-quoi de magnétique, un sex appeal tape-à-l’œil fané qui provoque, chez celles et ceux qu’il subjugue, une certaine fascination. Beau parleur, éternel adolescent dont la gloire est depuis longtemps ensevelie sous une couche de mensonges et de mauvaises décisions, il ne peut — ou ne veut — s’ajuster au monde adulte, rêvant de glitter et de lube et d’une jeune rouquine qui vend des beignes. Narcissiste, individualiste, hyperactif. Une caricature ? On voudrait le croire, mais cette figure polarisante qu’on aime et qu’on déteste est, en fin de compte, criante de vérité; un archétype nourri aux clichés dès la plus tendre enfance, aux opinions arrêtées, au comportement provoquant d’innombrables dommages collatéraux.
Voilà que le titre semble prendre ici tout son sens. D’aucuns pourraient y voir une métaphore de la personnalité incandescente, de l’énergie hyperactive de Mikey Saber, ex-vedette de films pour adultes incarnée ici par l’infatigable Simon Rex. Soit. Mais les plus fins, ou tout simplement les plus bilingues d’entre nous, qui maîtrisent peut-être — non sans une certaine fierté — quelques expressions de slang, savent vraiment ce dont il s’agit. Oh ! oui, ils savent. Ceux-là mêmes qui ont déjà un sourire en coin en ayant lu le titre sans même en connaître le propos. Car oui, ce red rocket désigne, purement et simplement, une érection canine. Nul besoin de verser dans la surinterprétation. Une bête réaction physique basée sur le désir qui, bien souvent pour le pire, outrepasse, contourne la raison. Tout est dit. Mais une question demeure : aurait-on assisté au grand retour de la prothèse pénienne de Mark Wahlberg près de 25 ans après Boogie Nights ? En fait, probablement pas. Car, en fouillant ici et là, on découvre assez facilement que Simon Rex est le parfait exemple d’une réalité qui dépasse la fiction. D’abord acteur de films pour adultes, il devient par la suite mannequin puis VJ à MTV et rappeur sous le pseudonyme Dirt Nasty (évidemment). Bien qu’il ait incarné des rôles très secondaires dans quelques films comme Scary Movie 3, Rex tient, dans Red Rocket, son premier grand rôle au cinéma où il étale toute son authenticité, son énergie brute et son sourire niais à vélo.
Mikey entretient un flirt risqué avec Strawberry, 17 ans, qui culmine dans une finale nimbée de teintes rose et jaune, symbole d’un avenir meilleur telle cette fuite à Disney World à la fin de The Florida Project. Mais cette finale bonbon est-elle bien réelle ou n’est-ce qu’un bref moment de grâce avant une débâcle qu’on imagine inévitable ? Ou est-ce une manière de renvoyer ce fantasme résolument cliché au visage de tous ces hommes en crise, si prévisibles et petits, qui gonflent leur ego à l’aide des pires artifices ? Au-delà du décor et de Mikey, c’est la richesse des personnages secondaires — qui incarnent le seuil entre naturalisme et caricature — qui fait la force du film. Lexi (Bree Elrod) et sa mère qui fument comme les raffineries qui les entourent, la dealeuse vétérane et sa fille qui ne se laisse pas impressionner, le voisin mytho qui provoque un carambolage; des personnages d’une banalité déconcertante et, pourtant, plus grands que nature, vrais et crus, sortis d’un vox pop sur une chaîne locale de la Fox. Il y a là un potentiel narratif inépuisable que Baker exploite avec une efficacité redoutable.
Chose certaine, Sean Baker trouverait sa place dans un hypothétique pique-nique avec les frères Safdie, Andrea Arnold et Harmony Korine.
Festif.
Poursuivre en ligne le 27e festival Cinémania
15 novembre 2021
2-21 novembre en ligne
Daniel Racine
Nous sommes tous tannés de cette pandémie qui s’étire, mais un des bons côtés de ces mois de confinement et de reprises progressives, c’est que la majorité des festivals de cinéma ont désormais une présence en ligne. C’est le cas du festival Cinémania qui se poursuit encore une semaine, sans que nous ayons à mettre le pied dehors.
Au niveau de la programmation, cette 27e édition ressemble aux éditions précédentes, avec des œuvres primées qui marqueront définitivement l’année et plusieurs films qui seront très vites oubliés. Voici une sélection de quelques titres (en plus de ceux dans mon texte précédent) qui seront accessibles dans les prochains jours sur le site du festival, quelques longs métrages qui ont pris ou prendront l’affiche très prochainement, et d’autres qui sont en attente d’un distributeur.
Amants de Nicole Garcia
Bientôt en salle au Québec

Il y a de ces films que nous aimerions pouvoir nous faire rembourser le temps que nous y avons consacré. Malheureusement, Amants est l’un de ceux-là. Comment se fait-il qu’une réalisatrice d’expérience comme Nicole Garcia (Le fils préféré, Place Vendôme, L’adversaire, Mal de pierres) puisse nous offrir un long métrage aussi générique et aseptisé que celui-ci. De l’intrigue molle au jeu désincarné de ses trois vedettes (Stacy Martin véritable porte-manteau, Pierre Niney perdu, et Benoît Magimel de plus en plus caricatural), rien ne peut sauver ce récit usé du triangle amoureux, triangle dont les coins sont beaucoup trop arrondis.
Boîte noire de Yann Gozlan
Maintenant en salle partout au Québec

Pas facile de faire un thriller sur le monde de l’aviation qui ne tombe pas dans les clichés d’usage. C’est pourtant la prouesse du réalisateur Yann Gozlan avec son très réussi Boîte noire. Utilisant avec intelligence les codes du cinéma complotiste très présent dans le cinéma américain des années 70 et début 80 (référence évidente au travail sonore de Blow Out de Brian De Palma), cette histoire d’enquête sur le contenu des bandes audios d’un vol commercial Paris-Dubaï a juste assez de fausses pistes pour nous garder en haleine. Et Pierre Niney nous offre l’une de ces meilleures performances, bien loin de celle générique dans l’ennuyant Amants de Nicole Garcia.
Le dernier voyage de Romain Quirot
À voir en ligne

Du cinéma de science-fiction tout droit sorti de l’Hexagone? Oui, ça se peut! Et Romain Quirot se débrouille plutôt bien pour son premier long métrage, inspiré de l’un de ses courts. Sans révolutionner le genre, Quirot ose mettre de l’avant un anti-héros qui erre et se questionne, plutôt que de nous proposer un mâle alpha à l’égo démesuré. Visuellement hypnotique, très conscient de piger aussi dans le western, Le dernier voyage confirme qu’il faudra garder un œil sur Romain Quirot, un peu comme nous savions très bien que Jean-Pierre Jeunet se démarquerait après son Delicatessen.
Rien à foutre de Emmanuel Marre & Julie Lecoustre
En attente d’un distributeur

Premier long métrage prometteur du duo des Français Emmanuel Marre et Julie Lecoustre, Rien à foutre a un titre révélateur, se jouant des codes entre le drame et la comédie, entre la fiction et le documentaire. Mais c’est parfois problématique au niveau du ton, le spectateur ne sachant pas trop sur quel pied danser. Heureusement, il y a Adèle Exarchopoulos qui a tout compris, telle une funambule au-dessus de la mêlée, elle navigue entre ciel et terre sans jamais perdre l’équilibre.
Rouge de Farid Bentoumi
À voir en ligne

Deuxième long métrage du réalisateur franco-algérien Farid Bentoumi, Rouge est un drame environnemental honnête, un peu prévisible, mais qui s’en tire bien grâce à son actrice Zita Hanrot. Découverte dans l’excellent Fatima, Hanrot nous embarque dans sa quête, sans jamais que nous remettions en question sa démarche tellement elle est convaincante. La construction du récit est efficace, avec une fin qui évite habillement le happy end. Un peu comme le récent Dark Waters de Todd Haynes, Rouge est satisfaisant, mais il manque un je-ne-sais-quoi pour que le film soit mémorable.
Serre-moi fort de Mathieu Amalric
En attente d’un distributeur

Tranquillement, mais sûrement, Mathieu Amalric est en train de devenir l’une des plus belles voix du cinéma français. Après le sublime Barbara, Amalric nous propose un récit déconstruit et organique, sur une femme qui décide (ou pas) de s’éloigner de son mari et de ses deux enfants. Menée par une Vicky Krieps bouleversante et tellement juste, Serre-moi fort porte bien son titre, le genre d’œuvre très puissante à chérir longtemps et à partager avec seulement ceux qu’on aime.
Seules les bêtes de Dominik Moll
En salle dès le 26 novembre

Avec deux comédiens déjà habitués aux Cévennes (Damien Bonnard dans Rester vertical et Laure Calamy dans Antoinette dans les Cévennes), Dominik Moll nous plonge dans sa nouvelle intrigue au cœur de cette région la moins densément peuplée de France. Raconté en trois temps, Seules les bêtes démarre sur des émotions vives, s’essouffle avec un récit outre-mer, et tente de tout ficeler maladroitement dans le dernier tiers. En voulant trop en faire, le cinéaste de l’inoubliable Harry, un ami qui vous veut du bien peine à nous convaincre et nous laisse sur notre faim.
Vedette de Claudine Bories & Patrice Chagnard
À voir en ligne

Il y a des synchronicités surprenantes dans le monde cinématographique. Au même moment où Cow sera présenté aux RIDM, de la réputée cinéaste britannique Andrea Arnold, le public de Cinémania découvrira le très attachant Vedette du duo Claudine Bories et Patrice Chagnard. Si le premier documentaire met en scène une vache digne de l’univers de la réalisatrice derrière Red Road et American Honey, nous montrant la déshumanisation de l’extraction du lait dans les imposantes fermes laitières, Vedette est davantage un portrait joyeux d’une vache de combat qui semble s’épanouir au pied des alpes françaises. Une belle surprise attachante et réjouissante.
Séquences à Dok Leipzig 2021
11 novembre 2021
Les multiples formes du documentaire
Jérôme Michaud
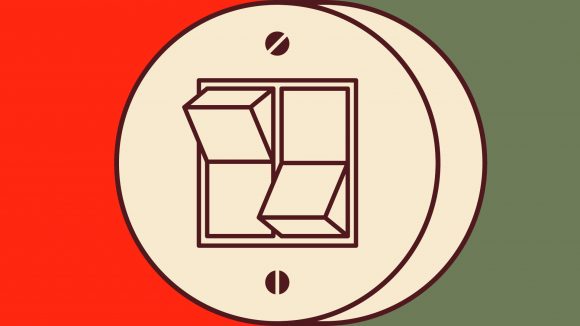
À la fin octobre, Dok Leipzig revenait pour sa 64e édition et sa sélection réservait, comme chaque année, quelques perles. On y retrouvait notamment le très attendu A Night of Knowing Nothing, gagnant de l’Œil d’or du meilleur documentaire au dernier Festival de Cannes. Le film se retrouvera également aux RIDM, pour une représentation en salle seulement, le 17 novembre.

Si on ne parle jamais de chef-d’œuvre dans le cas des documentaires, c’est plus par habitude que parce que cette terminologie ne s’y appliquerait pas. A Night of Knowing Nothing, premier long métrage de la cinéaste indienne Payal Kapadia, est une œuvre majeure qui se sert de sa lenteur d’une manière redoutable. Sa réalisatrice a entièrement compris la force des contrastes au cinéma, alors qu’elle parvient à rendre absolument révoltantes des images de brutalité policière, et ce, parce qu’elle les place savamment dans des segments d’une douceur prononcée.
Depuis 2015, les manifestations étudiantes font rage en Inde. Elles sont menées par un mouvement de gauche anti-caste qui est, notamment, contre la mise en place de personnes proches du pouvoir dans des postes d’influence des universités et contre la hausse des frais de scolarité. Kapadia, tout en renseignant son spectateur, propose de passer par des lettres d’amour fictives et une narration écrite pour déployer son film d’une belle hybridité : entre fiction et documentaire, entre film expérimental et archives. La cinéaste fait preuve d’une maîtrise de la composition assez rare et complètement envoûtante de laquelle émanent beauté, nostalgie et lumière, et ce, malgré la sombre répression dépeinte.
En donnant l’exemple d’une série d’actes violents qu’elle répertorie chronologiquement par l’intermédiaire d’archives journalistiques, elle dresse le constat que nous avons perdu beaucoup de sensibilité face à la souffrance d’autrui : une tragédie n’attend plus l’autre dans un monde médiatiquement connecté. À l’aide de sa démarche magnifiquement élaborée et profondément sentie, Kapadia parvient de belle manière, l’espace d’un instant, à nous redonner cette affectivité perdue, ce qui est loin d’être anodin!
Dans un geste qui comprend une certaine similitude, Republic of Silence de Diana El Jeiroudi est l’un des rares documentaires qui parvient à faire ressentir avec autant de force le parcours dans la durée d’exilés syriens. Ce tour de force est rendu possible parce que la cinéaste a documenté depuis plus d’une décennie sa propre histoire et celles de ses proches.
Portraits intimes, certes, mais pas que, puisque la première moitié du film, plus spécifiquement que la deuxième, incorpore de nombreuses images d’archives qui permettent de restituer une partie de la grande Histoire. La construction narrative du film est définitivement d’une grande richesse. Même s’il y a une forme de chronologie temporelle, l’œuvre fait plusieurs allers-retours habiles entre présent et passé, ce qui permet de rendre plus tangible le traumatisme que portent toujours en mémoire les protagonistes même plusieurs décennies après les faits.
La cinéaste articule deux moments fort différents qu’elle représente avec une belle honnêteté. Les années en Syrie sont marquées par une militance active qui laisse progressivement place à des années plus calmes, alors qu’on constate un lent apaisement en Allemagne. L’éloignement physique finit par créer une distance avec la guerre civile syrienne et El Jeiroudi en livre alors moins l’actualité, ce qui pourra donner l’impression à certains que le film s’égare, puisque cette bifurcation contraste avec la première partie. Republic of Silence s’intéresse définitivement plus aux humains derrière les horreurs qu’à l’histoire elle-même et c’est dans la proximité et l’intimité que la cinéaste ouvre qu’elle accroche viscéralement l’affectivité de son spectateur.
Murilo Salles, dans A Bay, se sert d’une approche qu’on pourrait dire aux antipodes des deux précédentes. Il convoque notre intellect pour rapprocher et donner consistance aux fragments librement détachés qu’il offre de la Baie de Guanabara, étendue d’eau qui borde Rio de Janeiro à l’est. Le cinéaste brésilien enchaîne huit segments sans liens évidents entre eux dans lesquels il dresse des portraits assez minimaux et allusifs de riverains vivant dans la précarité et devant cumuler les petits emplois pour survivre.

Tout cela pourrait être assez banal si Salles n’avait réussi à toujours faire signifier plus que ce qu’on voit au premier regard dans ses images. Dans A Bay, une opération de chargement de minerais dans un navire s’accompagne d’un bruit de tonnerre tonitruant, un hydravion de fortune est patiemment construit, en bonne partie grâce à des canettes de boissons gazeuses, la tête d’un cheval est filmée de près alors qu’il galope sur un remix psychotique de Carry That Weight des Beatles, etc. À l’aide d’une attention particulière accordée à l’alliage son et image, il travaille par contraste, juxtaposition et accumulation, parfois de façon assez appuyée. On pourrait alors lui reprocher de manquer de subtilité, mais il faut surtout y voir un désir de virulence qui dénote une lassitude devant les immenses inégalités sociales qui perdurent à Rio et en bordure de la Baie de Guanabara.
Par le biais d’approches assez différentes, mais toujours foncièrement cinématographiques, les trois cinéastes parviennent à stimuler le spectateur bien au-delà du sujet traité. Le documentaire contemporain ne cesse de remettre en cause sa forme classique et cela ne peut que légitimement réjouir ceux qui éprouvent une lassitude devant les tendances conformistes de la fiction.







