Articles récents
Films à voir, ou pas, au 27e Festival Cinémania
1er novembre 2021
2-14 novembre en salle > 2-21 novembre en ligne
Daniel Racine

Festival dédié aux films francophones depuis plus de 25 ans, né avant son alter ego français d’Angoulême, Cinémania prouve année après année sa pertinence et son importance dans notre écosystème cinématographique montréalais. Nous sommes loin de l’époque où le cinéma français occupait une place de choix sur nos écrans, c’est pourquoi la cuvée annuelle de Cinémania permet de combler l’absence ou la présence furtive d’œuvres fortes aux signatures identifiables par les cinéphiles, en plus de films grand public qui n’auront jamais la chance d’être distribués sur notre territoire.
Voici donc un survol de quelques films qui seront disponibles en ligne et/ou en salle dans les prochaines semaines du mois de novembre durant Cinémania.
5ème set de Quentin Reynaud
À voir en ligne seulement (pendant 48 heures)

Il y a toujours un danger à mettre en scène une réalité fictive ancrée dans le monde du sport. Un peu comme les univers de la musique ou de la danse, la difficulté réside dans la crédibilité de la performance physique de l’acteur ou de l’actrice : allons-nous y croire! Pour un premier long métrage réalisé en solo, le cinéaste Quentin Reynaud s’en tire plutôt bien, grâce aux impressionnantes prouesses d’Alex Lutz (que nous avions découvert dans Guy en 2017, rôle pour lequel il a reçu un César). L’acteur a su devenir un joueur vieillissant d’un bon niveau, malgré que Lutz n’eût jamais touché à une raquette de sa vie avant le tournage. Bien que ces scènes réussissent à être parfois déchirantes, entre les souffrances du corps qui s’accrochent et le questionnement intérieur du personnage, 5ème set s’étire inutilement.
Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit
À voir en ligne et en salle

Aucune étiquette ne colle au cinéaste Samuel Benchetrit. Après, entre autres, Janis et John, J’aurai voulu être un gangster et son précédent intitulé simplement Chien, celui qui est aussi auteur et dramaturge semble enfin trouver dans Cette musique ne joue pour personne l’équilibre idéal entre son humour décalé et une certaine humanité. Quel bonheur de voir JoeyStarr complice avec Bouli Lanners, le monolithe Gustave Kervern prendre vie aux côtés de la touchante Vanessa Paradis, et le duo Ramzy Bedia et François Damiens s’improviser poètes. Même si cette histoire de petits parias piétine un peu, de nombreuses séquences sont d’une redoutables efficacités, laissant place à des rires francs et un sentiment de perdre des connaissances sympathiques avec lesquels nous aurions poursuivies encore plusieurs minutes, ou quelques épisodes de plus.
France de Bruno Dumont
À voir en salle seulement

Léa Seydoux est partout cet automne : elle revient aux côtés de James Bond, elle est la muse de Benicio del Toro dans le nouveau Wes Anderson, et la voilà reine des ondes chez Bruno Dumont. L’ancien professeur de philosophie nous propose un regard cinglant sur le milieu des vedettes de l’information, et il a compris que Seydoux avait exactement ce qu’il cherchait pour ne pas tomber dans la facilité, soit l’aura d’une star et la fragilité d’une femme incomprise. Usant du malaise comme seul lui sait le faire, Bruno Dumont fait de France un puissant plaidoyer contre l’hypocrisie des médias de masse. France est une farce nécessaire à notre époque surmédiatisée et Bruno Dumont demeure le plus fascinant des réalisateurs français de notre époque.
L’événement d’Audrey Diwan
À voir en ligne et en salle

Lion d’Or amplement mérité à la dernière Mostra de Venise, L’événement d’Audrey Diwan fait écho au film Never Rarely Sometimes Always de l’américaine Eliza Hittman sorti l’an passé. Difficile d’admettre qu’il y a presque soixante ans d’écart entre ces deux époques fictives proches du réel, même si le premier se situe en France et le second aux États-Unis. Cela montre à quel point les femmes ne peuvent rien tenir pour acquis. Fortement influencé par la méthode des frères Dardenne, Audrey Diwan ne quitte jamais sa protagoniste et comme spectateur nous sommes carrément agrippés à la peau de la comédienne Anamaria Vartolomei, qui n’est rien de moins que formidable. Un film coup de poing avec certaines scènes quasi insoutenables, mais que tout le monde devrait voir pour bien comprendre les nombreux enjeux entourant l’avortement.
La fracture de Catherine Corsini
À voir en salle seulement

Définitivement le film le plus politique de la carrière de Catherine Corsini, La fracture raconte une nuit mouvementée (c’est un euphémisme) dans un hôpital parisien, un soir de manifestation des gilets jaunes. Si la cinéaste s’en tire bien dans son propos général, la surenchère des drames finit par nous faire décrocher. Toutefois, impossible de rester de glace devant l’intensité du jeu de Valéria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï et Aissatou Diallo Sagna, tous au sommet de leur art, passant avec aisance entre les différentes émotions que leurs personnages traverseront. Et pour qu’une réalisatrice habituée aux histoires d’amour prenne de front un sujet aussi brûlant, c’est qu’il y a réellement péril en la demeure.
La terre des hommes de Naël Marandin
À voir en ligne seulement (pendant 48 heures)

Retenez le nom de Diane Rouxel. Dans La terre des hommes, cette jeune actrice aux épaules fragiles montre avec force et nuance tous les sentiments qu’une femme peut traverser dans un monde dominé par les hommes. Le tour de force de Diane Rouxel, c’est de ne jamais tomber uniquement dans le rôle de la victime. Aidé du doigté du réalisateur Naël Marandin, le personnage porte bien le nom de Constance, car jamais la flamme en elle ne s’éteindra, peu importe les obstacles qu’elle devra affronter. Après l’excellent Petit paysan d’Hubert Charuel, voici un autre drame en milieu agricole qui nous prend à la gorge et durant lequel le spectateur ne craindra pas de se salir les yeux, à défaut des mains.
Médecin de nuit d’Elie Wajeman
À voir en ligne et en salle

Après Alyah et Les anarchistes, Elie Wajeman nous offre avec Médecin de nuit son film le plus maîtrisé, à la fois noir et plein de bonnes intentions. Une lente descente aux enfers, portée par un Vincent Macaigne magnétique qui tente par tous les moyens de ralentir sa chute. En voulant aider un peu trop les toxicomanes qu’il côtoie dans son travail, cet homme déchiré arrivera à l’heure des choix. Wajeman se la joue Scorsese, gardant bien en mains tous les aspects de son drame à la première personne. Une sombre pépite qui nous habite longtemps après le générique de fin.
Suprêmes d’Audrey Estrougo
À voir en salle seulement

JoeyStarr et Kool Shen, les deux porte-étendards du groupe rap français NTM, ont désormais leur film biographique. La réalisatrice Audrey Estrougo revient aux balbutiements de ce duo issu de la Seine-St-Denis, en suivant les codes du genre à la lettre, peut-être un peu trop. Mais les jeunes Théo Christine et Sandor Funtek sont tellement sincères et dynamiques dans leur performance, que nous nous laissons transporter par leur musique et nous suivons avec intérêt leur ascension jusqu’à leur premier concert au Zénith. Malgré le manque d’originalité, la formule est efficace et pourra satisfaire les fans comme les curieux.
No 328 – Se passer de commentaires
27 septembre 2021
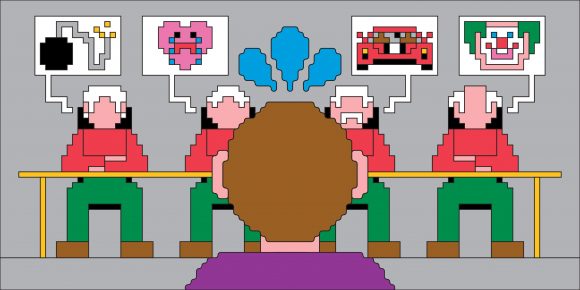
En guise de couperet, difficile d’imaginer phrase plus équivoque :
« Le jury a questionné la place de l’humour dans le thème de la quête identitaire d’un personnage métissé [sic]. »
Cette remarque, cryptique s’il en est, a été adressée récemment à Nicolas Krief, coscénariste de Jusqu’au déclin et réalisateur des courts métrages Skynet et Opération Carcajou, en réponse à projet de court métrage déposé au Conseil des arts et des lettres du Québec. Krief, né d’un père tunisien et d’une mère québécoise (donc métis, faut-il bêtement le souligner), l’a partagée publiquement en ligne, se contentant d’y ajouter un succinct « Y a encore du chemin à faire les potes, beaucoup de chemin ».
Notez que le jury n’a pas mis en doute l’humour en soi (est-ce drôle ?), mais la place de l’humour (peut-on/doit-on en rire ?) dans la quête identitaire d’un personnage métis. Le terme est galvaudé, mais il faut se prêter à d’étonnantes circonvolutions mentales pour ne pas considérer comme problématique cette position qui — et je cite à nouveau Krief, cette fois-ci dans une conversation que nous avons eue en privé — « invalide la démarche de l’auteur et se trouve à l’opposé des mesures que devraient entreprendre les institutions de financement qui veulent diversifier notre cinéma. Le danger avec un tel commentaire, c’est qu’il peut décourager, par exemple, une ou un cinéaste de la diversité de soumettre à nouveau son projet, ou même de poursuivre sa carrière artistique. » Cette question mériterait à elle seule tout un texte, mais je ne me sens pas assez outillé pour la développer adéquatement. Elle illustre tout de même dans le particulier un sac de nœuds que tous les cinéastes québécois devront tôt ou tard se coltiner : le retour des comités d’évaluation sur leurs projets de film.
Sans aucune prétention statistique, j’ai sondé il y a quelques semaines mon entourage dans le milieu : « Quelles sont les remarques les plus absurdes que vous avez reçues de la part de la SODEC, du CALQ, de Téléfilm Canada, par rapport à un scénario déposé ? » En quelques minutes, j’étais enseveli sous des dizaines de témoignages. Quelques critiques rapportées me sont apparues anodines, dans certains cas défendables. La majorité m’a rendu perplexe. Une ou deux m’ont carrément mise en colère. Par acquit de conscience, je n’en partagerai aucune ici, mais leur accumulation m’a rapidement démontré l’absurdité bureaucratique qui sous-tend toute évaluation d’œuvres artistiques (le cœur) par des entreprises dites culturelles (les poches).
L’opposition est facile : les pauvres créateurs incompris d’un côté, les méchants fonctionnaires de l’autre. Mais comment ne pas être le moindrement en colère de voir un scénario sur lequel on a planché durant des mois prendre le dalot pour des raisons en apparence insensées ? Vous me direz que si leur scénario avait été accepté, jamais ces artistes ils ne se plaindraient. Ce n’est pas faux. Et quel cinéaste établi n’a pas des tiroirs qui débordent de films avortés ? Stanley Kubrick n’a-t-il jamais pu tourner sa biographie rêvée de Napoléon ? Au Québec, Robert Morin vient de publier aux éditions Somme toute un recueil de trois scénarios tablettés (Scénarios refusés, notre recension en p. 50). Au moment de la mort en août dernier de Rock Demers, Radio-Canada nous rappelait dans sa notice nécrologique que le plus grand regret du créateur des Contes pour tous a été de ne pouvoir mettre à terme, à la fin de sa vie, un projet de film mettant en vedette un personnage autochtone. La SODEC avait refusé de le financer.
Il demeure facile de lancer des pierres sur des cibles qui ne peuvent se défendre, de juger a posteriori de « mauvaises » décisions, de sermonner des comités d’avoir dormi, par exemple, sur un talent comme celui de Myriam Verreault, qui a dû attendre dix ans après À l’ouest de Pluton pour enfin réaliser Kuessipan. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous dans les bottines de celleux qui siègent sur ces comités maudits, de ces jurés qui doivent lire attentivement, trier, soupeser, juger, trancher. Épineux, non ? J’irais même jusqu’à avancer qu’il n’y a pas de poste plus ingrat dans toute notre industrie. Cette autorité césarienne qui, sur un dix sous, peut assurer ou mettre fin à la carrière d’un cinéaste, peu doivent l’accueillir sans être conscients de son poids, des responsabilités qu’elle incombe.
Aucun système n’est parfait. Pour cela, il faudrait financer tout le monde sans distinction. Instaurer un système par ordre alphabétique, un tirage au sort. Une chasse aux œufs de Pâques, tiens. Quoique, nous ne sommes déjà plus très loin de la réalité. Mais admettre les failles inhérentes à la présente façon de procéder ne signifie pas pour autant accepter sans broncher les aberrations comme celle qu’a dû essuyer Nicolas Krief, nonobstant les qualités intrinsèques de son projet de film.
Dans ces cas, mieux vaut encore se passer de commentaires.
JASON BÉLIVEAU — RÉDACTEUR EN CHEF
Maria Chapdelaine
24 septembre 2021
Adaptation territoriale
Daniel Racine

Avant tout chose, il y a un désir. Celui d’un cinéaste qui portait en lui un roman retraçant un pan de l’histoire de son coin de pays, le lac Saint-Jean. Digéré depuis longtemps par Sébastien Pilote, le texte de Maria Chapdelaine, écrit par le Français Louis Hémon, fait écho au vécu territorial et au ressenti du réalisateur, à mille lieues d’un film de commande. Bien au contraire, il y a une réelle envie de revenir aux sources, à l’essence même du roman, mais aussi le choix judicieux de favoriser une approche artisanale, dans son sens le plus noble, par Pilote et son équipe. Cette adaptation au cinéma du classique littéraire, la quatrième à ce jour, n’est rien de moins qu’un des plus beaux films québécois de l’histoire de notre cinéma.
Si vous avez encore en tête quelques fragments de la version cinématographique ou télévisuelle du Maria Chapdelaine de Gilles Carle, vous découvrirez une tout autre démarche par le cinéaste du Vendeur (oublions les deux autres adaptations précédentes des Français Julien Duvivier et Marc Allégret, coincées dans les carcans de leur époque). Revenant à la simplicité du récit, à la nature des personnages (l’adolescente Sara Montpetit, qui incarne Maria, ayant l’âge de son héroïne, bien loin de Carole Laure, qui était dans la trentaine) et, surtout, à la compréhension de la faune et de la flore environnantes, Sébastien Pilote ne déroge pas de l’idée de vouloir rendre enfin justice à cette puissante histoire familiale et communautaire.
Composant son film en une série de chapitres, comme si nous enchaînions en salle plusieurs épisodes avec des protagonistes coutumiers, Sébastien Pilote prend le temps de nous présenter chaque personnage, des membres de la famille Chapdelaine aux multiples prétendants de la jeune femme, en plus des voisins que la forêt cache. Et pour que nous puissions pleinement nous approprier en images et en sons la terre que ces belles âmes défrichent à la sueur de leur front, Sébastien Pilote cartographie les environs avec un talent d’arpenteur, montrant les avancées récentes et l’ampleur du labeur à venir.
Pour capter tant la beauté du geste de déraciner une souche que les couchers de soleil sur cette clairière de nature humaine où vivent les Chapdelaine, le cinéaste s’appuie sur sa complicité avec le directeur photo Michel La Veaux. Si ce magicien de la lumière nous avait déjà grandement impressionnés par la compréhension des paysages qu’il filmait dans Le démantèlement, Michel La Veaux confirme avec Maria Chapdelaine qu’il fait désormais partie des grands, aux côtés de ses mentors Michel Brault et Jean-Claude Labrecque. Digne d’un peintre naturaliste, il a une maîtrise du regard posé sur ce qui l’entoure, s’assurant de nous offrir la plus belle représentation de ce dont il est le témoin privilégié. Comme spectateurs, nous sommes éblouis par toutes les nuances qui illuminent nos yeux, absorbant la magnificence de ces forêts et de ces cours d’eau, de la richesse des émotions qui naissent sur tous ces visages. En préférant être hissé sur une grue à des dizaines de mètres de hauteur, avec tous les dangers que cela comporte, plutôt que d’utiliser un drone générique pour effectuer son travail sans pouvoir en garantir les qualités esthétiques, Michel La Veaux prouve qu’il fait bien son métier et pour les bonnes raisons.
Ce savoir-faire artisanal, plusieurs autres collaborateurs de Sébastien Pilote le démontrent dans cette œuvre. Des costumes de Francesca Chamberland, qui épousent bien la personnalité de chacun, à la rigoureuse direction artistique de Jean Babin, chaque métier semble avoir compris parfaitement les souhaits du réalisateur. Il en va de même de Philippe Brault; le compositeur a su souligner juste assez certaines scènes, maîtrisant avec aisance l’intensité de ses accompagnements sonores.
Et il y a aussi toute l’équipe de comédiens, que Sébastien Pilote a dirigés adroitement, chacune et chacun jouant la même partition, valorisant le travail d’équipe plutôt que la compétition. En arrêtant son choix sur la jeune Sara Montpetit, Sébastien Pilote a vu juste. Pour un premier rôle au cinéma, celle que nous pourrons voir l’an prochain dans Chien blanc d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Falcon Lake de Charlotte Le Bon est une force tranquille, capable d’être à la fois physique et possédant une riche intériorité. Avec son faciès angélique et son fier caractère, Montpetit n’est pas sans nous rappeler Geneviève Bujold à ses débuts, celle qui a éventuellement interprété Élisabeth dans le Kamouraska de Claude Jutra, autre classique de chez nous sur les possibles amours d’une jeune femme. Sébastien Ricard continue sur sa belle lancée, campant un Samuel Chapdelaine exigeant, mais bienveillant. Hélène Florent le seconde bien à la tête de ce clan, créant une Laura Chapdelaine droite et souriante, ne s’en laissant pas imposer par les rigueurs de sa réalité, et ne se gênant pas pour partager tout haut ses états d’âme. Les trois prétendants affichent avec retenue leurs différents étendards : c’est Émile Schneider qui porte en lui les élans d’un François Paradis vite attachant; Antoine Olivier Pilon, discret et vaillant, nous montre un Eutrope Gagnon serein et présent; et Robert Naylor, le malhabile et riche Lorenzo Surprenant, a bien compris les prétentions de son personnage. Encore une fois, Martin Dubreuil excelle dans tous les plans où son Edwige Légaré se trouve, entre l’effort du gars des bois et la farce rassembleuse bien racontée autour du feu.
Sébastien Pilote, si bien entouré, a construit une magnifique fresque humaine et vivante. Après son Maria Chapdelaine, gageons que plus jamais personne ne voudra adapter le roman de Louis Hémon, tellement sa compréhension par le cinéaste originaire de Saint-Ambroise est totale. Les images de Michel La Veaux nous resteront en tête longtemps, tout comme les flammes brunes du regard perçant de Sara Montpetit. Pour pleinement l’apprécier, c’est certainement sur grand écran qu’il vous faut découvrir ce film plein d’amour et de résilience, ce dont nous avons bien besoin à notre époque où les désirs n’ont plus le temps d’attendre le prochain printemps.







