Articles récents
Errance sans retour
25 février 2021
Donner voix aux Rohingyas
Jérôme Delgado

Kutupalong, au Bangladesh, quelque part en 2018. La caméra nous entraîne dans un camp de réfugiés au travers de ses innombrables sentiers en terre, pour ne pas dire dans la boue. Pas n’importe quel camp. Avec les 600 000 personnes qu’il accueille, soit davantage que la population de la ville de Québec, Kutupalong est considéré comme le plus peuplé de tous. Il s’agit d’une véritable cité, bâtie à flanc de montagne.
C’est dans ce coin du globe qu’ont trouvé refuge les Rohingyas, population en majorité de confession musulmane pourchassée au Myanmar. Le documentaire Errance sans retour, réalisé par Olivier Higgins et Mélanie Carrier, donne une (très) bonne idée de leurs désormais nouvelles conditions de vie. Ils peuvent avoir fui la répression et la violence, Kutupalong n’est pas un avenir. Il se dresse comme un mur sans issue. Documenter, ici, prend tout son sens. Enregistrer en images et en sons le quotidien de ces gens sert non seulement la mémoire, cela donne aussi une preuve de la défaillance planétaire. Ce que deviennent les errants Rohingyas vaut pour toutes les populations apatrides, pour lesquelles la communauté internationale n’arrive pas à statuer, faute de moyens ou de volonté politique. Les flux migratoires font certes partie de l’histoire de l’humanité, mais le combat pour la paix et l’égalité semble loin d’être gagné, cent ans après la fondation de la Société des nations, l’ancêtre de l’Organisation des Nations unies.
Higgins et Carrier auraient pu réaliser un film sombre et sobre, tant le désarroi devant eux, immense, appelait la retenue, la discrétion. C’est d’autant plus vrai qu’ils ont entièrement tourné, si on ose dire, à l’intérieur des murs – sauf pour les quelques vues à vol d’oiseau, qui montrent l’ampleur du territoire. Mais Errance sans retour n’est pas qu’une plongée étouffante parmi une enfilade de baraques. Sans contourner le problème, ni l’enjoliver, le duo de réalisateurs parvient à tirer un récit éclairant et respectueux, jamais pesant, à peine redondant. Rythmé par des scènes de joutes au ballon rond sur un terrain cabossé et inondé – du foot aquatique ! –, le documentaire puise dans le réel des moments sinon de beauté, de plaisir, d’évasion, de défoulement collectif.
Dans les faits, les documentaristes jouent les observateurs. La narration vient de la voix d’un jeune réfugié, Kalam. Son histoire et son parcours servent d’exemple. C’est la manière de nous les rendre qui donne à Errance sans retour son intérêt, sa singularité. On ne voit jamais Kalam parler à l’écran. Le jeune homme, ou les jeunes hommes qui apparaissent devant la caméra, incarnent mille et un individus. Ce que Kalam raconte à la première personne, c’est tout autant ce que d’autres pourraient raconter. Le narrateur nous entraîne non seulement dans le labyrinthe du camp, mais aussi dans celui de la nuit, et de ses fantômes, dans celui de l’avenir, plombé de toutes parts. Blessures physiques, études écourtées, familles brisées : les séquelles sont multiples. Malgré tout, le ton n’est pas larmoyant. La forme n’est pas que descriptive. Le plan sur un salon de coiffure parle de la débrouillardise – il suffit d’apercevoir où a été accroché le miroir. Les séquences nocturnes, par les jeux d’ombres qui les animent, sont habitées des cauchemars de Kalam. Le dessin d’enfant filmé en gros plan et expliqué par son auteur évoque l’accompagnement thérapeutique dont bénéficient, à tout le moins, les plus jeunes réfugiés.
Si les mots de Kalam et ceux livrés devant la caméra, notamment par des femmes – un signe de la confiance gagnée par les documentaristes –, détaillent des faits, ceux-ci tomberaient à plat sans le soin apporté aux images. Il faut souligner l’apport de Renaud Philippe, directeur photo pour l’occasion. En réalité, le film repose entièrement sur le travail de celui qui est à la base photojournaliste. C’est lui qui est d’abord allé, seul, à Kutupalong. De ce premier voyage est né le projet d’un long métrage documentaire. Il est à noter qu’Errance sans retour n’est pas que le simple relais du reportage photographique de Renaud – aucune suite d’images fixes à l’écran, comme on aurait pu s’y attendre. Le film est une œuvre cinématographique à part entière.
No 325 – Fatigue et enchantement
6 janvier 2021

Il faut s’organiser. Je me suis installé un bureau à l’étage de mon appartement. Peinture aux teintes apaisantes, lampe murale et chandelles IKEA, la totale. Entouré de piles de magazines et de livres, structures vacillantes et précaires, je réponds à mes courriels, assiste à d’inéluctables réunions Zoom, vois mes journées s’égrener au rythme de courts métrages que j’écoute pour le travail, un premier avec le café matinal, un deuxième sur l’heure du dîner, un troisième en fin d’après-midi, un dernier en soupant. Les apôtres de l’ultralibéralisme et de l’autorégulation des marchés peuvent dormir sur les deux oreilles : le confinement rend productif. À vrai dire, je ne l’ai probablement jamais autant été, productif, chaque minute étant réfléchie et investie en fonction des menues tâches à accomplir. Manufacture d’objectifs à rayer de mon cahier Rhodia, ce minuscule espace circonscrit mon existence pandémique, et malgré l’épuisement certain, celui de ne pas savoir, ou de ne pas pouvoir savoir, j’y suis tout de même bien.
Le soir, je lis. Black Light. Pour une histoire du cinéma noir et Joan Crawford. Hollywood Monster, publiés par l’excellent distributeur français Capricci. L’essai Xénomorphe. Alien ou les mutations d’une franchise de Megan Bédard, paru aux Éditions de ta mère. Patti Smith, des livres d’histoire… n’importe quoi. Lutter par l’absorption d’informations brutes, s’accrocher à celles-ci comme un enfant s’accroche à son jouet préféré, par cette crainte irrationnelle qu’on lui ravisse pour toujours. Gobe, gobe, gobe. Je me sens comme ces extraterrestres ou ces humains du futur qu’on voit dans les films, qui atterrissent sur terre ou à notre époque et qui, grâce à des pouvoirs mentaux inédits, font défiler sur un ordinateur et intègre toute notre culture et notre histoire en trois minutes. Tout y passe, sans distinction ou hiérarchie : des sublimes films de l’Égyptien Shadi Abdel Salam (Le paysan éloquent et La momie) aux vidéos de youtubeurs comme Scott the Woz, analysant avec humour et érudition l’industrie du jeu vidéo.
L’hiver a pris ses aises, mais nous sommes engourdis déjà depuis des mois par la routine et la lumière blafarde de nos écrans. Cet état de flottement perpétuel m’a ramené à la mémoire l’essai documentaire Ne croyez surtout pas que je hurle de Frank Beauvais, vu à la Cinémathèque québécoise dans le cadre du Festival du nouveau cinéma en 2019. En retrait du monde suite à une rupture amoureuse difficile, Beauvais voit pour oublier, ou plutôt pour étouffer sa peine, quatre ou cinq films par jour, sur une période de plusieurs mois. Il en tirera un montage d’extraits de 400 métrages, la plupart obscurs, courtepointe rythmant de façon frénétique le récit narré à la première personne d’une perte, et d’un retour graduel à la vie « normale ». Je pense à ce film bouleversant parce que je me demande – et je n’ai pas de réponse – si le cinéma m’aide à oublier, ou au contraire à me souvenir une vie d’avant. Simulacre ou miroir fidèle. Un peu des deux bien sûr.
Présentement mis à l’épreuve dans ses fonctions divertissantes, le cinéma s’avère (je n’en ai jamais vraiment douté) de solides béquilles, et bien qu’il fasse gris dehors et à l’intérieur depuis mars dernier, je sais maintenant que je ne serai jamais tout à fait triste ou désemparé tant que j’aurai des films à ma portée. Tant qu’il me restera des films d’Éric Rohmer à découvrir ou revoir, tant que je pourrai compter sur une comédie de Steve Martin pour me remonter le moral, tant qu’il y aura des tops de fin d’année à établir et la promesse d’un retour dans les salles obscures, où nous pourrons tous nous ensemble saisir l’étrange imprévisibilité du monde.
JASON BÉLIVEAU
RÉDACTEUR EN CHEF
Soit dit en passant : Autobiographie de Woody Allen
18 novembre 2020
Yves Laberge
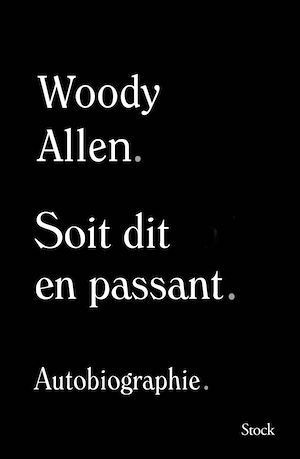
Je crois que Woody Allen est le plus important cinéaste des États-Unis depuis 50 ans : indéniablement le plus original dans la conception de ses scénarios (Woody et les robots, Zelig, La Rose pourpre du Caire), le plus profond (Intérieurs, Manhattan), de loin le plus drôle, certainement le plus prolifique et le plus constant. Et j’ajouterais à ce préambule que ses œuvres sont beaucoup plus raffinées et cultivées que la moyenne des films hollywoodiens, car son univers est rempli de références subtiles (et d’hommages) aux plus grands réalisateurs européens, par exemple dans Stardust Memories (Fellini) ou dans Hannah et ses sœurs, dont le prologue évoque l’ouverture faste de Fanny et Alexandre (de Bergman). Et pourtant, autant la critique américaine a surestimé des metteurs en scènes populaires comme Martin Scorsese ou Steven Spielberg, elle a tout autant sous-estimé la plupart des films de Woody Allen; ce manque de jugement généralisé prouve une fois de plus que beaucoup de critiques américains ne font que de répéter ce qui s’écrit ailleurs, dans un pays où le talent est calculé en fonction du nombre d’entrées en salles, de profits réalisés et de statuettes accumulées. Cela prouve également que n’importe qui peut devenir un commentateur de films et être parfois bien payé pour cela.
Woody Allen est controversé et mal aimé dans sa patrie, comme l’ont été avant lui d’autres réalisateurs importants — et dérangeants pour le système — comme Charles Chaplin, Orson Welles, Elia Kazan — pour ne nommer qu’eux. Mais ce désamour est un peu compensé par un succès international qui ne se dément pas. Au fond, Woody Allen n’est pas qu’un cinéaste américain; il est davantage un artiste universel, bien qu’il ait concentré tant de ses récits sur New York et la Côte Est des États-Unis. D’ailleurs, il y a très longtemps, quelqu’un de très célèbre déclarait que « Nul n’est prophète en son pays ».
La principale différence entre ce nouveau livre et les biographies précédentes réside dans le style inimitable de l’auteur, qui met en évidence la singularité de notre monde et de lui-même. Le livre Soit dit en passant : Autobiographie regorge de moments savoureux, comme cette visite de courtoisie à la maison de campagne de l’actrice Muriel Hemingway et de sa famille, qui se termina pour Woody Allen par un rapatriement par avion vers New York. Par ailleurs, et pour notre plus grand plaisir de cinéphile, presque tous ses longs métrages seront ici commentés, et on en compte une cinquantaine.
Rétrospectivement, Woody Allen revient à plus d’un endroit sur les recettes décevantes de certains de ses films récents et s’explique mal plusieurs de ses insuccès commerciaux; paradoxalement, en fait, l’artiste peut difficilement comprendre que, comme pour Bergman et Fellini, un grand auteur de cinéma échafaude un œuvre (ici j’emploie le terme « œuvre » au masculin, pour désigner l’ensemble de ses productions), et de ce fait, chaque nouvelle pierre — chaque nouveau long métrage — s’ajoute aux précédentes et forme un ensemble cohérent, avec des thèmes constants — que d’autres percevront comme des redites. Mais ce sont des variations sur un même thème, et c’est traditionnellement le propre du grand Art. En conséquence, ses films ont une longue vie et ne se limitent pas aux six mois suivant leur sortie : ils sont intemporels. Et ses films en DVD ou en Blu-Ray auraient sans doute plus de succès au Québec s’ils étaient disponibles en version doublée en français, ce qui n’est plus le cas depuis plus de vingt ans! Et on ne trouve toujours pas d’intégrale ou de rétrospective de Woody Allen en Blu-ray.
Woody Allen reste peut-être son critique le plus exigeant : il se rappelle avoir voulu « jeter » son film Manhattan (1980) — avec Mariel Hemingway et Diane Keaton — après l’avoir monté! C’est pourtant son chef-d’œuvre! Un film considéré comme un sommet dans sa filmographie, auquel l’universitaire américaine Anne Gillain avait même consacré toute une monographie (Nathan Université, 1997)!
Un peu comme Sacha Guitry avec plus de cent pièces de théâtre et une vingtaine de films à son actif, Woody Allen regrette de ne pas avoir produit un grand film; mais dans l’ensemble, on pourrait se satisfaire pour moins que cela. Et la lecture de Soit dit en passant nous rappelle la richesse et l’originalité de ce corpus. Et pourtant, je ne suis pas un inconditionnel de Woody Allen.
On ne s’ennuie jamais en lisant ce livre substantiel et informatif, sauf peut-être dans les pages parfois laborieuses sur les encombrements de sa vie privée. Mais cela fait aussi partie du mythe.
–
Woody Allen
Soit dit en passant : Autobiographie
Paris, Stock
2020, 535 p.







