Articles récents
Les siffleurs
2 juillet 2020
Crimes et sifflements
Jérôme Michaud

Siffloter sa chanson préférée avec élégance n’est pas l’apanage de tous, mais il faut dire que l’on a rarement à le faire, les soirées endiablées de karaoké ne demandant pas d’entrer dans ce genre de technicalité, qui redonnerait pourtant un peu de lustre aux classiques souvent maltraités au petit matin. Cela dit, savoir siffler n’est pas du tout essentiel et personne ne perdra la vie s’il ne maîtrise l’art de former de petits bruits stridents émanant de sa bouche, à moins qu’il ne se trouve inexplicablement plongé dans l’univers des Siffleurs, dernier opus du déstabilisant cinéaste Corneliu Porumboiu. Partant de la pratique traditionnelle du langage sifflé silbo gomero pratiqué sur l’île de La Gomera dans l’archipel des Canaries, le cinéaste roumain s’inspire du film noir pour élaborer une intrigue alambiquée, mais finement ficelée dont les quelques apories sont rapidement pardonnées.
Dans une atmosphère où tout le monde est sous écoute, où chacun tente de protéger ses arrières et de dissimuler ses intentions, Cristi, impassible policier de la brigade des stupéfiants de Bucarest, s’est acoquiné avec la pègre, ne cessant d’informer son contact Zsolt de l’enquête menée contre lui, la faramineuse somme de 30 millions d’euros étant en jeu. Suite à l’arrestation de Zsolt, que Cristi a tenté en vain de prévenir, ce dernier se rend à l’île de La Gomera, rejoindre Gilda, femme fatale dont le charme l’a envouté, et le reste de la bande de mafieux afin d’apprendre avec eux à gazouiller le silbo gomero, et ce, dans le but d’utiliser ce moyen de communication secret pour faciliter l’évasion de Zsolt. L’art de siffloter devient ainsi l’élément pivot de la stratégie de libération, le moindre faux pas pouvant, théoriquement, mener à des conséquences tragiques.
On peut d’emblée reprocher à Porumboiu de se servir superficiellement du langage sifflé sur lequel il s’attarde pourtant longuement. Le silbo gomero, qui réduit le langage parlé à deux voyelles et quatre consonnes, aurait pu causer des quiproquos majeurs qui auraient servi de ressorts narratifs à l’intrigue, mais il n’en est rien. Cela dit, l’approche adoptée par le cinéaste produit une idéalisation d’un moyen de communication hautement faillible, mettant alors l’emphase sur la beauté sonore et musicale d’un chant intime qui a le grand avantage de permettre un échange hors du monde sans pour autant avoir à en sortir. Un peu comme si Porumboiu souhaitait pointer l’idée que ce dont on a aujourd’hui besoin est de retrouver une sphère privée, une façon d’être avec l’autre dans la confidentialité.
La grande force des Siffleurs est justement d’exposer la façon dont un individu peut se retrouver littéralement paralysé par une surveillance constante, réelle ou pressentie, technologique policière ou mafieuse. Caméras cachées ou téléphones sous écoute, si ce n’est que la police peut être à vos trousses, Porumboiu dresse le portrait d’un micro contrôle social d’une sournoiserie crasse apte à restreindre l’action au point de faire de quelqu’un le simple spectateur de sa propre vie, parfois même sans en avoir conscience. Si le film s’ouvre avec la mémorable pièce The Passenger d’Iggy Pop, c’est pour souligner que Cristi, protagoniste principal du film, n’aura qu’un rôle de passager, et ce, malgré la participation active qu’il tente d’avoir au sein de la rocambolesque histoire de gangsters dans laquelle il finira coincé entre ses collègues de la police et le groupe de mafieux. Il n’est pas anodin qu’il soit le dernier personnage formellement présenté à l’aide d’un intertitre, alors que les événements du film ont déjà diminué ses forces, formalisant son rôle d’observateur.
Le spectateur est aussi passagé d’un film dont les chamboulements incessants d’alliance deviendraient presque ridicules s’il n’était de la maîtrise de l’enchaînement dont Porumboiu fait preuve. Parsemée d’analepses explicatives, la première partie laisse ensuite place à une alternance entre les péripéties de Gilda et Cristi. À l’aide de ces deux modalités d’allers-retours qu’il maîtrise à merveille, Porumboiu met en place un rythme fluide capable de faire rougir tous les amateurs de karaoké dont le chant développe parfois une cadence erratique lorsque la nuit se prolonge.
No 323 – Prophètes de malheur
24 juin 2020
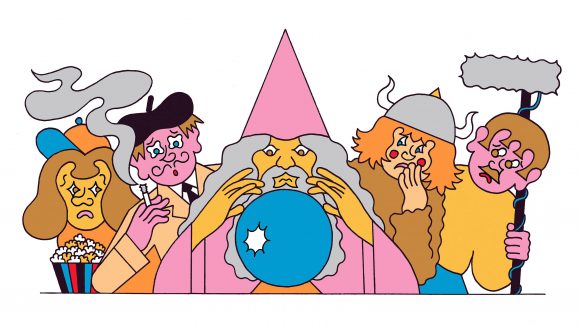
Au jeu des pronostics, l’industrie cinématographique s’est toujours révélée en trompe-la-mort. Depuis l’avènement du son dans les années 1920, cette « mort du cinéma » guette, telle une épée de Damoclès, à la faveur de chaque révolution technologique qui, supposément, viendrait sceller à jamais son sort. Pourtant, Hollywood continue de pondre des Fast & Furious aux deux ans et Vincent Guzzo de projeter des films pro-vie au nom de la liberté d’expression. Cette inclination du cinéma à toujours anticiper sa mort relève sans doute d’un plaisir masochiste, mais le septième art trouve aujourd’hui en la pandémie de COVID-19 un adversaire de taille qui, si elle ne lui assène pas ce coup de grâce tant redouté (ou secrètement désiré), accélérera sans doute, pour reprendre une formule récente de Michel Houellebecq, « certaines mutations en cours ».
Au Québec comme ailleurs, les inquiétudes sont grandes. Tournages suspendus, salles closes jusqu’à nouvel ordre, distributeurs désemparés : le portrait à court et à moyen terme n’a rien de reluisant. Dans l’attente, l’offre se concentre en ligne, les festivals s’adaptent, Netflix, Amazon Prime et les autres s’arrogent une part toujours plus grande du gâteau. Des laissés-pour-compte s’invitent à la fête : les ciné-parcs, réduits jusqu’alors à l’incongruité anachronique, à ranger aux côtés des Walkman jaunes de Sony et de Windows 95, reviennent à l’avant-scène, leurs handicaps devenant tout à coup d’indéniables avantages.
Le problème est complexe, truffé d’impondérables, de « sans précédent » à s’en gratter la barbiche. Car nonobstant la qualité des contenus promotionnés, en la considérant uniquement comme une machine à fric, l’industrie du cinéma continue (pour l’instant) d’être profitable. Et dans quelques cas précis, elle ne l’a jamais autant été, à un point tel qu’il serait difficile de ne pas considérer la salle comme un fâcheux intermédiaire. Le cas de Trolls World Tour est à cet effet probant. Proposé en PVOD (premium video on demand) le 10 avril dernier, après que sa sortie en salle a été suspendue, le film d’animation engrange en trois semaines plus de profits que son prédécesseur, Trolls, en cinq mois d’exploitation « classique ». Profits que la Universal n’aura pas à partager avec les grandes chaînes de salles, comme AMC et Regal aux États-Unis. Les représailles de ces deux dernières entreprises ne se sont pas fait attendre : elles refusent à l’avenir de projeter dans leurs complexes les films du studio proposés simultanément en PVOD.
Les spécificités attrayantes de la salle n’ont plus à être énumérées. Nous les connaissons toutes. Nous n’avons pas à défendre la légitimité de cette expérience exceptionnelle, demeurée la même dans son essence depuis le 28 décembre 1895. Mais, alors que plusieurs salles au Québec sont confrontées à de graves difficultés financières, que les distributeurs parviennent difficilement à faire du profit sur les films qu’ils défendent, que l’arrêt des tournages laisse présager une carence de nouveaux contenus pour les mois à venir, il faut se demander si le système en place sera toujours « viable » dans les mois et années à venir. C’est pour cette raison que nous consacrons 13 pages dans ce numéro à ces questions épineuses, dont les aboutissants n’ont pas fini de nous surprendre.
Nos pensées vont aux amis et amies cinéastes, producteurs et distributeurs, à celles et ceux qui dirigent, programment et coordonnent festivals, salles et cinéclubs. Oui, les critiques sont parfois cyniques. Oui, ils sont bons pour mettre en relief le laid, le négatif, ce qui ne fonctionne pas. Mais ils croient sans l’ombre d’un doute que nous nous reverrons tous très bientôt dans les salles de cinéma. Foi de prophètes de malheur.
JASON BÉLIVEAU
RÉDACTEUR EN CHEF
It Must Be Heaven
11 juin 2020
Briser le silence
Daniel Racine

Avec 4 longs métrages en 23 ans, et une décennie complète entre Le temps qu’il reste et son plus récent It Must Be Heaven, on peut affirmer que le cinéaste palestinien Elia Suleiman aime prendre son temps. Il sait que ses œuvres, qui prennent souvent la forme de séries de tableaux humoristico-mélancoliques, parfois autobiographiques, sont très attendues. La preuve étant ses sélections en compétition officielle au Festival de Cannes, où en mai dernier il remportait une mention spéciale du jury en plus du prix FIPRESCI. Alors, pourquoi se presser, surtout qu’il construit habilement ses récits de méticuleuses observations de sa vie de tous les jours. Pour créer, il doit vivre et regarder son quotidien défiler devant lui, afin d’en extraire l’essence même de son travail.
Il y a aussi l’inextinguible conflit israélo-palestinien, braise constante qui demeure la trame de fond du réalisateur d’Intervention divine. Comment peut-il garder un regard neuf sur d’aussi vieux affrontements ? Dans It Must Be Heaven, Suleiman a justement eu la bonne idée de quitter son territoire après quelques scènes dans des lieux plus familiers, pour aller voir ailleurs, soit à Paris et à New York, deux mégapoles qu’il connait bien. C’est en portant en lui son État, et en montrant les travers des autres, qu’Elia Suleiman nous offre son film le plus mature, et peut-être le plus politique, tout en bonifiant son point de vue.
Si la majorité de ces séquences peuvent paraître d’une grande simplicité, c’est que Suleiman conserve uniquement ce qui est essentiel et universel pour mettre en scène sa vision de son « réel ». Comme cette série de tableaux avec un voisin, qu’il surprend dans son citronnier en train de voler quelques fruits. D’une fois à l’autre, celui qui « partage leur frontière commune » s’incrustera davantage sur son terrain. Il n’en faut pas plus pour y voir une illustration forte et amusante de cet envahisseur israélien. Et comme toujours, le personnage qu’incarne Elia Suleiman (ES est le nom donné à son protagoniste dans les descriptifs) communiquera uniquement par ses expressions faciales, de l’agacement à la désapprobation, de la stupéfaction à l’espoir retrouvé.
À ce sujet, les comparaisons sont fréquentes avec l’Étatsunien Buster Keaton et surtout le Français Jacques Tati. Pourtant, ce n’est pas tant dans leur personnage presque muet que dans la construction de leur mise en scène qu’il faudrait trouver d’importantes inspirations et ressemblances. C’est dans le volet parisien de son périple hors du Moyen-Orient que l’influence du créateur de Jour de fête est particulièrement frappante chez Suleiman. Que ce soit par le défilé des top-modèles dans une rue piétonnière de la capitale ou le ballet des policiers sur leur gyroroue, ces scènes font écho à la minutie et à la précision du Playtime de Tati. Les deux cinéastes partagent aussi une fascination pour les transports et les technologies, ces domaines étant souvent les bases de leurs meilleurs gags visuels. Mais chez Suleiman, il faut y ajouter l’aspect sécuritaire. L’omniprésence de l’armée ou de la police est frappante dans It Must Be Heaven, mais n’est pas surprenante quand on sait d’où il vient. Lui seul pouvait réussir à filmer une file de tanks face à la Banque de France et à fournir des armes à tous les passants de New York. Il ne craint pas l’exagération, sans toutefois noyer ses farces, pour que nous puissions à la fois rire et réfléchir.
Pour la première fois, Suleiman partage l’écran avec des personnalités connues, pour mieux illustrer l’isolement de son coin du monde. Ça débute à Paris, dans le bureau de Vincent Maraval, fondateur de la société de distribution et de ventes internationales de films Wild Bunch. Le cinéaste-acteur s’amuse en lui offrant un rôle sur mesure, Maraval tentant maladroitement d’expliquer à Suleiman qu’il refuse son prochain scénario de film parce qu’il n’est pas assez palestinien, « ça pourrait même se passer ici », lui dit-il, par cette belle mise en abyme. Il en sera de même à New York, où il rencontre la vedette mexicaine Gaël García Bernal, ce dernier qui patiente pour négocier un éventuel projet de film pour souligner le 500e anniversaire de la conquête mexicaine (tourné en anglais, bien entendu) avec la productrice québécoise Nancy Grant, celle qui est derrière les plus gros succès de Xavier Dolan. Même si García Bernal les présente, en précisant que Suleiman tourne une comédie sur la paix en Palestine, elle lance « c’est déjà drôle », lui serre la main en lui souhaitant la meilleure des chances, sans plus. L’intelligence et la pertinence de Suleiman sont là, dans ses deux refus qui en disent long sur le regard que nous portons collectivement sur le peuple palestinien. Toujours prêt à les reconnaître, comme ce chauffeur de taxi new-yorkais qui téléphone à sa femme pour lui dire qu’il est avec un Palestinien dans sa voiture, mais sans jamais être prêt à les aider concrètement.
C’est aussi dans ce taxi que le personnage de Suleiman parle pour la première fois. Dans Chronique d’une disparition en 1996, la genèse de sa filmographie, il était invité devant une salle pleine pour s’exprimer sur sa démarche artistique. Si nous étions convaincus de l’entendre, pourtant, dès qu’il s’approcha du micro, l’effet Larsen l’empêcha de prendre la parole. Il a conservé ce type de mise en situation tout au long de sa carrière, mais cette fois-ci, à la suite de la question du chauffeur « de quel pays viens-tu ? », ES, sans trop hésiter, répond « Nazareth », suivi de « je suis Palestinien ». Cela est très surprenant pour tous ceux et celles qui connaissent ses longs métrages presque par cœur. Elia Suleiman vient de prononcer quelques syllabes. L’importance de ses choix de mots est sans équivoque. Ce paradis sur lequel il semble s’interroger tout au long de ce voyage cinématographique, c’est son identité qu’il porte comme son ultime salut. Il brise enfin son silence pour affirmer haut et fort ce qui le définit, ce qui l’habite, ce qui fait de lui un cinéaste essentiel à notre compréhension du monde dans lequel nous vivons. It Must Be Heaven est un magnifique cri du cœur, tout en douceur et en subtilité, d’un personnage qui boit pour se souvenir et qui garde espoir en voyant les jeunes palestiniens danser, comme tous les jeunes de la planète.







